LA SÉLECTION 2022 DU PRIX DU ROMAN D’ÉCOLOGIE (5)
« Pour garder une trace de ce monde en péril »
Entretien de Corinne Royer avec Maxime Morin autour de Pleine terre
Corinne Royer est l’un des six écrivain.e.s qui ont été nominé.e.s pour le Prix du roman d’écologie 2022. Ce prix récompensera en avril « un roman francophone paru l’année précédant l’attribution, de grande qualité́ littéraire où les questions écologiques sont substantiellement présentes ». Les années précédentes, Lucie Rico, Emmanuelle Pagano, Serge Joncour et Vincent Villeminot ont déjà été primé.e.s, pour des romans très différents mais qui, chacun à sa façon, font résonner notre rapport à l’environnement. Pour la troisième année de suite, Literature.green a réalisé des entretiens avec les nominé.e.s du Prix qui ont accepté de répondre à nos questions.
Pour en savoir plus sur le Prix du Roman d’Écologie: https://prixduromandecologie.fr/
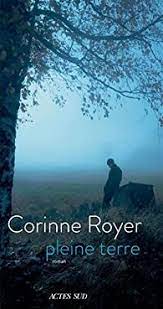
Corinne Royer est romancière. Elle a déjà publié cinq romans : deux aux Éditions Héloïse d’Ormesson (M comme Mohican en 2009 et La Vie contrariée de Louise en 2012 – qui a reçu le Prix Terre de France/La Montagne la même année ) et trois chez Actes Sud (Et leurs baisers au loin les suivent en 2016 ; Ce qui nous revient en 2019 et Pleine terre en 2021). Ces deux derniers romans s’inscrivent dans la même démarche : explorer, au moyen de la fiction, des faits réels.
Maxime Morin : Votre dernier roman, Pleine terre, s’inspire de l’histoire tragique de Jérôme Laronze, agriculteur et militant tué par les gendarmes. Ce n’est pas la première fois que vous partez d’un fait divers, d’une vie oubliée de l’Histoire, pour en faire le sujet d’un roman. Dans Ce qui nous revient, votre avant-dernier roman, vous racontiez l’histoire de Marthe Gautier, qui a mis au jour le chromosome surnuméraire de la trisomie 21 mais que l’Histoire n’a pas retenue. La littérature est-elle pour vous vouée à rendre justice aux écartés ?
Corinne Royer : Je crois que la fiction a toujours affaire au réel. Ce qui m’intéresse est d’écrire autour de ce qui me touche, me bouleverse, me questionne. En cela, tout peut devenir matériau romanesque dès lors que l’on sait se rendre poreux au monde qui nous entoure. Et inversement : le réel a toujours affaire à la fiction. Ce que l’on raconte autour d’un fait avéré, je dirais d’ailleurs davantage « fait de société » que « fait divers », la façon même dont on le raconte est forcément subjective, elle dépend de notre positionnement par rapport à ce fait, de nos sensibilités et de nos acquis (sociaux, moraux, affectifs etc…). L’éclairage d’un fait est tributaire de celui qui décide du type de lumière qu’il va y projeter, de sa propension à ne dire que ce qui est certain, et cela pose bien sûr la délicate question de la certitude, ou, au contraire, de remplir les blancs d’une histoire, d’imaginer, d’entrer en résonnance avec ce qui est supposé s’être passé. Mes deux derniers romans s’inscrivent dans cette démarche : à partir de faits réels, ouvrir le champ de la fiction et de la résonnance, tenter d’exprimer par le filtre de l’intime et du sensitif ce que ces faits peuvent dire du monde, de ses errements, de ses marches forcées mais aussi de ses espérances têtues. Il n’y a pas d’intention initiale à rendre justice aux écartés mais il se trouve que ce sont ces histoires-là qui m’inspirent, celles des oubliés de l’Histoire, des sacrifiés du système. Il ne s’agit pas d’être juge ou censeur mais de restituer ce qu’une destinée individuelle peut, sous le sceau d’un pacte fictionnel assumé et clairement énoncé, attester des manquements ou des abus collectifs d’une société dans un contexte donné, à un moment donné.
M. M. : L’oubli est un thème très présent dans Pleine terre. L’agriculture industrielle, écrit le narrateur, est « [vouée] à anéantir les connaissances de tant de générations de paysans. On tentait de leur arracher la mémoire – bientôt, les fils d’agriculteurs ne sauraient plus ce que leurs ancêtres avaient su. Il était temps de s’opposer à cette amnésie ». Cette dernière phrase est-elle le programme de votre roman, ou du moins son art poétique ?
C. R. : Pleine terre s’empare d’un être que le système veut effacer, l’effacer lui et, à travers lui, effacer ses pratiques, son rapport à la terre et aux bêtes, en fin de compte effacer son rapport singulier au monde. C’est un agriculteur en lutte avec le système agricole productiviste et avec les injonctions administratives qui en sont les garantes, c’est l’homme révolté de Camus, un homme qui dit non, qui refuse mais qui combat, c’est-à-dire qui ne renonce pas. Et pour garder une trace de ce monde en péril, de son monde, celui des petites fermes qui disparaissent, celui de cette nature en sursis et celui des espérances confisquées, pour dire ce qui bientôt entrera dans l’oubli, il décide d’écrire une lettre. Cette lettre est un des points clés du roman. Il écrit des mots les uns derrière les autres et les mots font sens, redonnent corps à son statut de paysan mais, surtout, ses mots, comme ceux de tous les livres qu’il a lus, tracent un sillon, évitent l’effacement qui menace le savoir-faire et les convictions dans lesquels il s’inscrit. Il espère que ses mots seront lus et compris, qu’ils constitueront une mémoire de ses luttes et de son combat. C’est à la fois une façon de ralentir l’amnésie collective à défaut de la circonscrire tout à fait et un hommage rendu à la puissance de ce qui est écrit, qui ne pourra être nié, qui perdurera donc, qui résistera à l’effacement. Établir cette trace, cette mémoire en quelque sorte, de tout ce qui a été et qui demeure menacé au point de disparaître, est l’ultime acte de courage et d’opposition du personnage révolté qu’est Jacques Bonhomme.
M. M. : Le récit de la cavale est raconté du point de vue de Jacques. Dans ces chapitres, on croirait assister à une venue au monde, comme dans Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier. En s’échappant, il retrouve son « libre arbitre » : « Jacques Bonhomme redevint un être de chair et de sang et le monde redevint monde ». Avez-vous voulu décrire les métamorphoses d’un homme rendu à la vie par le refus radical de l’aliénation ?
C. R. : Jacques quitte sa ferme et ses bêtes parce qu’il y est contraint mais également parce qu’il ressent le besoin de s’éloigner de la société des hommes, de calmer sa colère et de remettre de l’ordre dans ses idées. Lors de cette fuite qui va se transformer en cavale, puisque les forces de l’ordre se lancent à sa poursuite et le traquent pendant neuf jours, il va osciller entre des périodes de grand chaos induites par sa condition d’homme traqué et des périodes de communion totale avec la nature au sein de laquelle il se réfugie : les forêts, les étangs, les champs. Neuf jours et huit nuits au cours desquels on va suivre les métamorphoses du corps en action, les tensions de muscles, le carillonnement du cœur, etc, mais également la façon dont il reprend la main sur sa propre existence, cette exaltation liée à un sentiment de liberté recouvrée et cette capacité à s’émerveiller devant les beautés simples et rassurantes des éléments qui l’entourent. En faisant corps avec la nature, c’est sa propre identité qu’il retrouve, celle d’un être capable d’agir sur le monde avec discernement et volonté. Il réalise alors que ce que la société lui prend, sa ferme, son troupeau, il ne pourra à nouveau se l’approprier qu’après avoir sauvé l’essentiel : son libre arbitre et sa conscience d’homme. En cela, oui, il opère pendant ces neuf jours une forme de renaissance.

Corinne Royer
M. M. : La révolte de Jacques Bonhomme ressemble à celle de Ned Ludd, chef imaginaire d’un mouvement bien réel, celui des ouvriers anglais qui, au début du XIXe siècle, se révoltèrent contre les machines par l’intermédiaire desquelles on les exploitait – donnant ainsi naissance à ce qu’on appelle la « technocritique ». Rousseau, Giono et Ramuz, que vous citez, sont souvent identifiés comme des auteurs technocritiques. Qualifieriez-vous votre roman de roman technocritique ?
C. R. : Toute une génération d’agriculteurs a vu dans l’industrialisation et la chimie la promesse de jours meilleurs, la possibilité de produire davantage avec moins d’efforts et de sueur.
Aujourd’hui, la sélection à outrance des espèces, les productions de masse, la robotisation semblent révéler les excès d’une modernité qui se retourne contre ceux qu’elle est censée aider et contre l’humanité de façon plus globale. Les pollutions, le réchauffement climatique, les maladies liées aux produits phytosanitaires sont autant de constats qui interrogent la place de l’homme dans cette grande course en avant. Nous savons parfaitement que cette modernité dégrade notre rapport au vivant, que plus les espèces sont sélectionnées, plus elles sont vulnérables et plus il faut alors d’antibiotiques et de vaccins, que les conditions d’élevage dans des bâtiments fermés, échine contre échine, avec un manque d’aération et des aliments non naturels favorisent les épidémies. Les agriculteurs ne se reconnaissent plus dans cette hyper technicité qui veut les faire passer du statut de paysan, d’agriculteur à celui de chef d’exploitation. Il y a là une perte de sens extrêmement dommageable à la fois pour les gens de la terre et pour la terre elle-même. Nous sommes passés de l’utopie d’une machine au service de l’homme à la réalité de l’homme au service de la machine. Pleine terre interroge ce glissement et ses conséquences pour l’avenir.
M. M. : Dans ma première question, j’ai utilisé le mot « vie », qui peut aussi être entendu du point de vue de l’histoire littéraire : une « vie », c’est le récit d’une existence sainte. Or, vous faites référence au christianisme à de nombreuses reprises : la paysannerie est dite être une « vocation », qui se transmet comme une « providence » ; Jacques Bonhomme s’exclame que « les bêtes sont les Christ » ; et il entend une voix, comme nombre de saintes et de saints avant lui. Pleine terre, est-ce aussi La Passion de Jacques Bonhomme ?
C. R. : Cette question me fait penser à une citation de René Char : « La vie aime la conscience qu’on a d’elle ». C’est-à-dire que, peut-être, avons-nous aussi perdu ce fil-là : celui des saisons avec leur lot de morts et de renaissances, celui des veaux extraits des ventres et de leur mort programmée pour nourrir l’humanité. Je crois qu’on ne peut parvenir à une véritable conscience de la vie qu’avec une véritable conscience de la mort. Et cette conscience de la mort est devenue taboue dans nos sociétés contemporaines. On peut effectivement associer à Jacques une figure christique tout d’abord parce qu’il porte cette parole, celle d’une pleine conscience des cycles et des saisons, d’une mort inéluctable et d’une résurrection possible. Ensuite, parce que, d’une certaine façon, ses neufs jours de cavale constituent une quête spirituelle, une élévation, notamment dans le chapitre où il retrouve la petite clairière de son adolescence, un lieu où il parle d’égal à égal avec Dieu. Il y a également dans son parcours une dimension sacrificielle, il se fait porte-parole d’une communauté et érige quasiment en religion son rapport à la terre, il sera poursuivi, humilié et châtié pour cela, mais il ira jusqu’au bout de son chemin de croix. Sans doute, malgré tout, sa foi en la communauté des paysans, sa foi en des lendemains qui pourraient chanter si l’on voulait bien résister au système dominant lui octroie ce supplément d’âme propre aux hommes qui, d’une manière ou d’une autre, ont quelque accointance avec le divin.
Pour citer cet article :
Maxime Morine, Corinne Royer, “‘Pour garder une trace de ce monde en péril’. Entretien de Corinne Royer avec Maxime Morin autour de Pleine terre”, Literature.green, avril 2022, URL: https://www.literature.green/entretien-royer-pleine-terre/, page consultée le [date]
