LA SÉLECTION 2021 DU PRIX DU ROMAN D’ÉCOLOGIE (5)
La mémoire des lions
Entretien de Colin Niel avec Sara Buekens autour d’Entre Fauves
Colin Niel est l’un.e des six écrivain.e.s qui ont été nominé.e.s pour le Prix du roman d’écologie 2021. Ce prix récompensera en avril «un roman francophone paru l’année précédant l’attribution, de grande qualité́ littéraire où les questions écologiques sont substantiellement présentes». Les années précédentes, Emmanuelle Pagano, Serge Joncour et Vincent Villeminot ont déjà été primé.e.s, pour des romans très différents mais qui chacun à sa façon font résonner notre rapport à l’environnement. Pour la deuxième année de suite, Literature.green a réalisé des entretiens avec les nominé.e.s du Prix qui ont accepté de répondre à nos questions.
Pour en savoir plus sur le Prix du Roman d’Écologie: https://prixduromandecologie.fr/
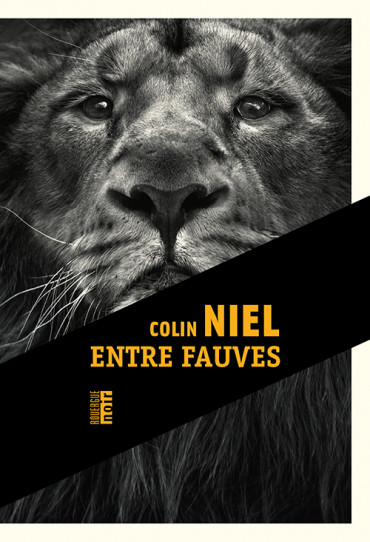
Colin Niel, diplômé en biologie de l’évolution et en écologie, a pendant longtemps travaillé pour la préservation de la biodiversité dans les parcs nationaux de guyane et de Guadeloupe. Ses expériences internationales dans le domaine de la protection de l’environnement imprègnent son œuvre dès les débuts de sa carrière littéraire. Dans son dernier roman, Entre fauves (Rouergue 2020), il aborde la question de la chasse aux trophées en Namibie.
Sara Buekens : Dans votre roman, vous opposez différents points de vue, par exemple celui de l’Occidental pour qui la chasse aux trophées est une pratique répugnante et une source de problèmes écologiques comme l’extinction des espèces animales, et celui de l’Africain pour qui l’animal sauvage constitue une menace économique et sociale concrète. On pourrait repérer ici la distinction entre l’écologisme naturaliste, qui est exclusivement centré sur l’environnement naturel, et l’écologisme social, qui s’intéresse au rapport entre la protection de la nature et les problèmes sociétaux qui pourraient y faire obstacle, comme la pauvreté, les guerres, l’instabilité politique. Comment réconcilier ces deux positions ?
Colin Niel : Quand j’écris, je ne cherche pas à défendre quoi que ce soit, ni à réconcilier des courants de pensée entre eux : j’écris des romans, des histoires, pas des manifestes. J’essaie de mettre en scène des personnages, et ce qui m’intéresse, ce n’est pas ma pensée, ma vision du monde, c’est la leur. Le roman me parait réussi lorsque j’ai l’impression d’avoir su m’effacer derrière eux. Pour parler écologie, le roman est surtout à mon avis le lieu où les grandes idées se heurtent au réel, à l’individu et à ses contradictions. C’est le lieu des émotions, du subjectif. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas de savoir qui a raison entre un Occidental opposé à la chasse aux trophées et un éleveur namibien dont le troupeau est menacé par un lion, ni d’essayer de les réconcilier, mais de faire vivre ces personnages avec leurs idées, leur histoire individuelle, leur culture, leurs priorités, leurs émotions. Ce n’est pas de convaincre le lecteur de quoi que ce soit, mais de l’immerger dans une réalité, si possible éloignée de la sienne, dans laquelle l’écologie se vit plus qu’elle ne se pense.
S.B. : Vous donnez également une voix à des animaux, comme le lion Charles, dont le lecteur apprend les pensées, qui s’expriment à travers le langage humain, dans des passages au discours indirect libre. On constate que ce lion est doté d’une mémoire et dispose d’une grande base de connaissances, même scientifiques (« Il attendit que vienne la nuit, la nuit de cet autre monde, […] celui des arbres mués en spectres échevelés, sterculias, pachypodiums, cyphostemmas »). Ne craignez-vous pas de tomber ainsi dans le piège de l’anthropomorphisme ?
C.N. : C’est une question que je me suis maintes fois posée lors de l’écriture. J’ai beaucoup lu sur le sujet, sur les grands mammifères, sur cette population de lions du désert, qui vit dans le Nord-Ouest de la Namibie. Et à vrai dire, je crois que le piège, ce n’est pas l’anthropomorphisme (même si le risque de plaquer des interprétations humaines sur des comportements animaux est bien réel), c’est l’inverse. Le piège, c’est de continuer à vouloir croire qu’il existe une frontière entre hommes et animaux, que nous sommes des animaux « à part », dotés d’une intelligence, d’émotions seulement humaines, alors que depuis des décennies, les scientifiques nous démontrent le contraire, mais aussi que tous ceux qui ont des animaux de compagnie l’expérimentent au quotidien. L’amour, la honte, le deuil, la culpabilité, la dépression… on sait aujourd’hui que toutes ces émotions, les animaux peuvent les ressentir, à leur manière. Alors non, je ne crois pas être tombé dans le piège de l’anthropomorphisme. Et oui, je crois que Charles, le lion de mon roman, est doté d’une grande mémoire, d’une immense connaissance de son territoire de vie et des espèces animales et végétales qui le composent (j’aurais pas mal d’anecdotes à raconter à ce sujet), même si, bien sûr, le langage que j’ai utilisé pour parler tout cela est un langage humain. Ce que je remarque, d’ailleurs, c’est que les quelques scientifiques ayant lu mon livre, dont deux chercheuses spécialisées dans les grand mammifères, n’ont aucunement été gênés par ces passages où le lecteur est plongé dans les pensées du lion. Ce qui m’a plutôt rassuré, je vous avoue.
S.B. : Voici la description de l’homme selon le lion Charles : « leurs silhouettes de bipèdes dressées dans le crépuscule […] leurs peaux couvertes d’autres peaux qui n’étaient pas les leurs ». Ce passage n’est pas sans faire penser à une forme d’antispécisme, qui consiste à attribuer une valeur égale à tous les êtres vivants et à nier la supériorité de l’humain. Cette position est encore renforcée par le fait que vous faites de l’animal un personnage à part entière, auquel le lecteur peut s’identifier. Considériez-vous votre œuvre comme un roman antispéciste ?
C.N. : Je ne crois pas non, en tout cas je ne l’ai jamais pensée ainsi. Oui, Charles est un personnage du roman à part entière : il souffre, il pense, il réfléchit, car je suis convaincu que tout cela fait partie de la vie d’un lion. Mais ce n’est pas un jugement sur la « valeur » des êtres vivants. Ce qui m’intéressait, c’était les rapports que nous, humains, entretenons avec ces autres animaux, selon notre propre histoire ou culture. Une chasseuse de grande faune africaine, un éleveur namibien, ou un garde de parc national, n’ont bien entendu pas du tout la même vision de ce qu’est un lion, et ne lui attribuent pas la même « valeur ». Mais dans l’écriture du roman, j’ai essayé d’accorder la même importance à chacun de leurs points de vue. De m’interdire de porter moi-même un jugement.

Colin Niel
S.B. : L’ironie, que nous retrouvons aussi dans la description que je viens de citer, est omniprésente dans votre roman. Je pense par exemple au passage où Martin fait remarquer que l’humanité est responsable de la disparition de « deux cents espèces de vertébrés éteintes en moins d’un siècle, aucun autre animal ne peut se vanter d’un tel record ». L’attitude de distanciation critique à laquelle invite le procédé littéraire de l’ironie est-elle indispensable à une prise de conscience écologique ?
C.N. : Peut-être, oui. Mais je ne crois pas avoir écrit ce livre pour permettre une prise de conscience écologique. En matière de chasse aux trophées, le sujet central du livre, je crois que la prise de conscience est déjà là, que chacun a déjà son avis sur la question, souvent très tranché. Cette conscience écologique, j’aurais tendance à la considérer comme un préalable au livre. Je pense plutôt me situer après. Ce que je voulais, c’était justement questionner cette conscience, évoluer dans les « zones grises », dans ces situations où la question du bien et du mal commencent à se mélanger, où on commence à s’interroger sur qui sont les gentils et les méchants. Je crois que le terrain du roman, et notamment du roman noir, c’est celui-là.
S.B. : En tant qu’écrivain, vous faites d’abord une œuvre de littérature : existe-t-il une difficulté à tenir en équilibre les exigences du style et un positionnement envers l’environnement ? Dans quelle mesure est-ce que la « matière de l’écologie », toujours au sens large, vous a incité à repenser la forme traditionnelle du polar ? Est-ce le sujet environnemental qui s’est prêté à la forme de l’enquête ou est-ce le genre policier qui s’est imposé au sujet ?
C.N. : À vrai dire je ne sais pas. Il est clair que l’écologie est un sujet majeur aujourd’hui, et donc qu’elle inspire de plus en plus. Pour ma part, avant d’écrire, j’ai travaillé pendant 12 ans dans ce qu’on appelle la « protection de la nature », j’ai été directeur adjoint du parc national de la Guadeloupe, responsable de la création d’un autre, en Guyane. Je crois donc que c’est assez naturellement que la question écologique, ou plus largement du rapport des hommes au milieu dans lequel ils évoluent, a toujours été présente dans mes romans. Mais encore une fois, je ne pense pas qu’un roman (et notamment un roman dit « noir ») ait vocation à prendre « position » vis-à-vis de l’environnement.
S.B. : Dans votre roman, vous accordez une place importante aux images, aux discours qu’elles peuvent faire naître et aux actions auxquelles elles peuvent mener. En outre, vos descriptions sont particulièrement « imagées », évoquant en détail les formes, les couleurs et les matières de la nature du Nord-Ouest désertique de la Namibie et des paysages enneigés des Pyrénées. La fiction et les images peuvent-elles jouer un rôle dans le contexte actuel de crise environnementale ? Pourriez-vous préciser lequel ? Le roman, dont le terrain d’action est l’imaginaire, dispose-t-il d’atouts spécifiques pour faire résonner les enjeux écologiques ?
C.N. : Oui, je suis vraiment convaincu que les images, mais aussi la fiction, jouent un rôle déterminant dans notre vision du monde et des enjeux écologiques. D’abord parce qu’elles font appel à nos émotions, nous choquent, nous blessent, nous font rire, donc nous marquent. Mais aussi parce qu’elles sont vues ou lues par bien plus de monde que n’importe quel documentaire ou rapport scientifique. Le pouvoir des images et de la fiction (littéraire ou audiovisuelle) est donc à mon avis très important en matière écologique. Malheureusement, c’est à double tranchant : faire appel aux émotions, c’est un moyen de mobiliser, mais c’est aussi dangereux, parce que certains des grands défis écologiques n’ont pas la même capacité que d’autres à émouvoir. Parce que, par exemple, le sort des pandas préoccupe beaucoup plus que celui des lombrics ou des insectes, dont la disparition serait pourtant une catastrophe.
Pour citer cet article:
Sara Buekens, Colin Niel, «La mémoire des lions. Entretien de Colin Niel avec Sara Buekens autour d’Entre Fauves» in Literature.green, mars 2021, URL: https://www.literature.green/la-memoire-des-lions-entretien-colin-niel-entre-fauves/ , page consultée le [date].
