LA SÉLECTION 2020 DU PRIX DU ROMAN D’ÉCOLOGIE (3)
Un paysage aride et l'(im)puissance des mots
Entretien de Thomas Giraud avec l’équipe Literature.green autour du Bruit des tuiles
Thomas Giraud est l’un des six écrivain.e.s qui ont été nominé.e.s pour le Prix du roman d’écologie 2020. Ce prix récompensera en avril « un roman francophone paru l’année précédant l’attribution, de grande qualité́ littéraire où les questions écologiques sont substantiellement présentes ». Les années précédentes, Emmanuelle Pagano et Serge Joncour ont déjà été primé.e.s, pour des romans très différents mais qui chacun à leur façon font résonner notre rapport à l’environnement. Literature.green a réalisé des entretiens avec les nominé.e.s du Prix qui ont accepté de répondre à nos questions.
Pour en savoir plus sur le Prix du Roman d’Écologie: https://prixduromandecologie.fr/
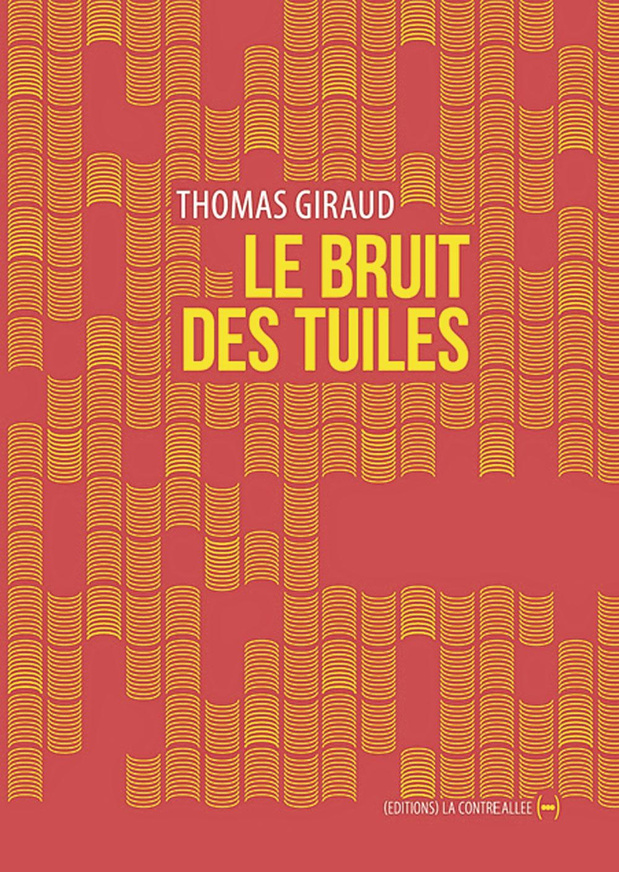
Thomas Giraud est né en 1976 à Paris. Docteur en droit public, il vit et travaille à Nantes. Dans son premier roman Élisée, avant les ruisseaux et les montagnes (La contre allée, 2016), il imagine ce qu’ont pu être certains épisodes de la vie d’Elisée Reclus (1830-1905), géographe et précurseur de la pensée écologique. La Ballade silencieuse de Jackson C. Frank (La contre allée, 2018), son deuxième roman, retrace le parcours du chanteur folk méconnu Jackson C. Frank.
Dans Le Bruit des tuiles (La contre allée, 2019), Thomas Giraud s’intéresse à l’histoire de Réunion, la communauté utopique fondée au Texas en 1855 par l’économiste polytechnicien Victor Considerant, disciple de Charles Fourier. Le roman décrit la colonie fouriériste dans ses cinq ans d’existence, et il imagine ses habitants et les différentes difficultés qu’ils ont dû affronter, allant des conflits interpersonnels jusqu’aux aléas climatiques et naturels.
Est-ce que pendant l’écriture du Bruit des tuiles vous aviez conscience de vous inscrire dans une perspective écologique au sens large et qui implique une curiosité pour le monde dont l’horizon dépasse le strict intérêt des humains ? Était-ce un choix délibéré dès le départ d’écrire un roman « écologique » ?
Thomas Giraud : Je ne me suis pas posé la question en ces termes-là, aussi bien dans la préparation mentale du livre, cette lente gestation dont on n’est pas forcément acteur, ni pendant l’écriture elle-même. Peut-être parce que le mot « écologique » recouvre des significations différentes. À titre personnel, l’écologie est nécessairement politique et je ne crois pas avoir fait un livre politique, même si dans Le bruit des tuiles la politique est une préoccupation des personnages. En revanche, ce qui est certain, et cela recoupe ce que vous nommez « perspective écologique », au moins dans un sens large, le paysage, réel ou imaginaire, les relations des uns et des autres avec ce paysage, les déplacements dans la nature, ce que nous faisons de la nature mais aussi ce qu’elle fait de nous, ce que c’est qu’une ville (car l’écologie n’est pas évidemment pas synonyme de nature, c’est aussi comment vivre ensemble sur un territoire) constituent un élément fondamental de mon écriture. Que ce soit dans Élisée, avant les ruisseaux et les montagnes, La ballade silencieuse de Jackson C. Frank et dans Le Bruit des tuiles, les gens se déplacent, regardent la forme d’une colline ou celle des villes, les arbres, le ciel, même si, très vite, cela prend des tournures assez subjectives (le goût de l’air, la forme des nuages et ce que le vent peut, par exemple). Après je lis beaucoup d’essais sur la nature, le déplacement et cet objet que constitue, voire constituerait, la nature (la manière de la penser, de la regarder, d’en parler, d’observer quelle peut être notre place là-dedans): cela est au cœur de mes préoccupations et d’une partie de mes lectures plus théoriques (je pense notamment à plusieurs livres publiés par les éditions Dehors comme le récent Le toucher du monde. Techniques du naturer, ou Nature et récits de Williman Cronon mais aussi aux ouvrages de Tim Ingold dans lesquels la nature n’est jamais bien loin). C’est une préoccupation permanente et ancienne.
L’écologie apparaît aujourd’hui comme un nouvel universalisme : pour la nouvelle génération c’est un idéal –ou une utopie– qui permet une mobilisation importante. Estimez-vous que l’engagement, tenu en suspicion depuis la faillite des grandes idéologies du XXe siècle, pourrait grâce à l’écologie retrouver aujourd’hui une certaine légitimité ? Dans quelle mesure et par quels moyens?
T. G. : De nombreuses idéologies ont fait faillite, probablement pour des raisons différentes. Certaines étaient intenables car abominables, criminelles en elles-mêmes, d’autres ont échoué pour la manière autoritaire et parfois criminelle aussi de leur mise en œuvre. Pour autant, je suis de ceux qui croient aux idées, à leur force. L’idéologie des idéologues est problématique ; mais d’ailleurs ceux qui revendiquent la fin des idéologies sont souvent eux-mêmes des idéologues qui font de la fin des idéologies leur idéologie, pour nous servir, le plus souvent, une pensée politique molle, faite d’eau tiède et de beaucoup de compromis peu glorieux. Les idées, qu’on les appelle principes, convictions, lignes de conduite, espérances, programmes me semblent indispensables et l’écologie pourrait être, selon la manière dont on la définit, un terreau fertile pour construire une pensée politique, peut-être utopiste, mais qui permettrait de changer un peu sinon le monde, au moins la manière dont certains vivent. Je crois que l’écologie, notamment quand elle s’appuie sur des travaux sociologiques, géographiques, peut offrir une analyse féconde de la société. Elle permet par exemple de faire apparaître la manière dont les hommes et les femmes travaillent, quelles sont les zones les plus exposées aux pollutions et est-ce que les pollueurs vivent aux mêmes endroits que les pollués. Mais l’écologie peut être aussi un moyen d’action au cœur de la société. Une manière de se rencontrer, de parler, d’assumer des choix de vie ensemble, dans un quartier densément peuplé, un canton périurbain ou sur un territoire où tout est éloigné. Dans toutes ces acceptions, l’écologie peut servir à fonder un mouvement et être l’origine d’un engagement. Peut-être ne faut-il pas que ce soit sur un trop petit dénominateur commun. J’ai l’intuition que si l’écologie dans un sens fort, ne gagne que de minuscules batailles, si elle se contente d’être un peu de greenwashing de la part des grands pollueurs, si elle n’est qu’un supplément d’âme, elle ne permettra pas grand-chose. Une fois cette chose (assez banale) dite, je ne sais pas très bien quels seraient les moyens de consolider cet engagement. On sent dans la jeunesse des envies et on voit des attitudes fortes sur la manière de vivre, sur le rapport aux déchets, à la consommation. C’est l’engagement, la force politique que le nombre impose, le sentiment chevillé au corps de l’urgence à agir, l’imagination qui permettra peut-être de faire évoluer les choses. Mais on sait aussi tous les blocages politiques qui existent, l’influence de certains groupes économiques et à quels points ces groupes sont écoutés et pèsent de tout leur poids dans les politiques publiques.
La fiction peut-elle jouer un rôle dans le contexte actuel de crise environnementale ? Pourriez-vous préciser lequel ?
T. G : Je crois assez peu en la différence entre les faits et la fiction. Tout dépend bien entendu de ce que l’on appelle faits, mais la plupart du temps, même s’il faudrait évidemment un peu nuancer les choses, il n’existe pas de faits bruts et dès le premier mot dit, les premières phrases prononcées par quelqu’un pour parler de ces faits, une part de fiction entre en jeu. Les sciences elles-mêmes, au moins les sciences humaines, s’accompagnent de récits où la part de fiction, que l’on appellerait probablement davantage imagination, entre en jeu (je pense notamment au beau livre de Paul Veyne Comment on écrit l’histoire). D’ailleurs, en sens inverse, je ne crois pas du tout en une fiction qui serait détachée de tout élément concret réel. Chacun s’inspire d’expériences, de reconstitutions, d’observations. Alors pour répondre à votre question, oui, je suis persuadé que la fiction, pas plus que la science mais en prenant un autre chemin, peut jouer un rôle dans un contexte de crise environnementale. Elle peut bien sûr jouer un rôle sans lien avec des perspectives politiques, : elle permet de prendre le temps, de s’extraire d’un quotidien rythmé par une multitude d’injonctions (souvent contradictoires), par cette performance qui nous est si souvent rabâchée. Écrire de la fiction ou lire de la fiction, c’est presque par définition tourner le dos pendant quelques heures aux principes économiques qui font de la productivité l’alpha et l’oméga de la vie, qui conduisent le monde à la crise écologique que l’on connaît. Bien entendu la fiction peut aussi d’avantage. Je risque de faire quelques lieux communs mais il me semble que les représentations du monde des auteurs, les perceptions du monde, passées, actuelles et futures que ceux-ci nous donnent à voir, la manière dont les fictions sont tricotées modifient parfois certains comportements ou, peut-être seulement mais ce n’est pas rien, la manière de regarder les choses. Je suppose que certains livres peuvent marquer chez chacun un changement dans la perception d’un phénomène en lien avec l’écologie.
De la même façon, et ça sera une manière de regrouper mes deux séries de réponses à cette question, la poésie me semble pouvoir beaucoup dans ces temps d’urgence. Elle n’apporte aucune connaissance du monde a priori, elle énonce des propos non vérifiables, émotifs et pourtant, parfois, elle est capable de produire beaucoup. Une phrase dont la construction nous arrête et résonne, une manière de faire marcher des mots ensemble sans que cela ait pu jusqu’à là nous paraître possible permet d’accéder à ce qui nous est si souvent refusé tous les jours : le temps pour soi, le temps pour comprendre ou seulement le temps pour se faire sa propre idée. Les petits livres de Marielle Macé Sidérer et considérer et Nos cabanes sont à ce titre assez illustratifs de ça. Le monde y est appréhendé autrement, avec des instruments inhabituels, la poésie, la littérature mais sans aucun dogmatisme et beaucoup d’empathie.
Le roman, dont le terrain d’action est l’imaginaire, dispose-t-il d’atouts spécifiques pour faire résonner les enjeux écologiques ?
T. G.: Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit forcément le meilleur moyen. C’est un moyen parmi d’autres de faire résonner de tels enjeux mais il n’a pas, évidemment, le monopole de l’imaginaire et je ne suis pas persuadé non plus que ce soit le roman qui parvienne le mieux à faire coïncider au XXIe siècle un monde imaginaire et des enjeux, qu’ils soient écologiques et/ou politiques. Bien entendu le roman peut être d’anticipation, être une dystopie, une utopie, une reconstitution possible, montrer où les choses nous mènent si l’on continue à ce train-là. Mais le cinéma le peut aussi, et probablement de manière plus efficace avec des atouts identiques à ceux du roman. Peut-être que le seul atout du roman pour faire résonner des enjeux écologiques tient plutôt à ce qui pourrait être présenté comme une faiblesse : le roman est nécessairement pour le lecteur celui du temps long, celui d’un temps dans lequel on fait le choix d’être actif et ou l’imaginaire du lecteur est mis à contribution. C’est ainsi moins l’imaginaire de l’auteur que celui du lecteur qui peut constituer une force.
En tant qu’écrivain, vous faites d’abord une œuvre de littérature : existe-t-il une difficulté à tenir en équilibre les exigences du style et un positionnement envers l’environnement?
Dans quelle mesure est-ce que la « matière de l’écologie », toujours au sens large, vous a incité à repenser la forme traditionnelle du roman ?
T. G. : La plupart des auteurs que je lis, ceux qui forcent l’inspiration tant je les admire, soit en m’agitant, soit en laissant s’infuser les choses dans mon esprit, bousculent la forme traditionnelle du roman. Que ce soient des enquêtes qui n’en sont pas, des romans immobiles, ceux où le vrai et le faux s’emmêlent, ceux où la ponctuation est réactivée dans sa fonction par un usage peu classique. Et si j’ai bien une certitude sur ce que je peux faire (et ce qui en constitue aussi une limite), c’est que mes livres soient construits d’une manière un peu inattendue. Alors bien sûr, je n’invente rien, mais je me mets dans les pas de ces écrivaines et écrivains que j’aime, qui me semblent bousculer (la narration dans le temps comme chez Claude Simon, la ponctuation comme chez Lobo Antunes), les influences se mélangent et de tout ça sort un gros bouillon qui constitue mes choix d’écriture. Et puisque l’écologie au sens large a une place forte dans ce que j’écris, rapidement les deux se mêlent. Je ne ressens pas de difficulté dans cet équilibre car, à vrai dire, je ne sens pas deux masses qu’il faudrait équilibrer. La langue et le paysage sont depuis que j’écris des alliés, des compagnons pas toujours très simples à convoquer mais qui, en tout cas, ne se chamaillent pas entre eux.
Y a-t-il, en matière de vision sur la nature, des auteurs ou des livres qui vous ont spécialement marqués ? Quel rôle ont-ils tenu dans votre parcours et dans votre écriture ?
T. G.: Je ne voudrais pas donner l’impression d’avoir trop bien préparé cette interview mais à quelques exceptions près, les auteurs qui comptent, qui sont devenus importants car en les lisant je me disais « Ah oui, on peut faire comme ça », donnent une place importante à la nature. Les premiers chronologiquement sont Jean Giono et Charles-Ferdinand Ramuz. Ils vivent dans des régions montagneuses tous les deux, peu de temps les sépare et j’ai été frappé chez l’un et l’autre par une représentation très vivante de la nature. La faune et la flore, mais pas seulement. Les pierres aussi vivent et grognent, le ciel et le reste. Chez Ramuz, les montagnes tremblent ou sont parfois mauvaises, les arbres respirent. Chez ces auteurs que je lis et relis abondement, il y a quelque chose de l’ordre de la fatalité dans ce rapport. Je retrouve çà, dans une moindre mesure mais tout de même, c’est là, chez Pierre Michon, Michel Jullien. Chez ces auteurs-là, on est ancré sur un territoire et ce sont les détails de celui-ci qui jaillissent. Je suis aussi très intéressé par les écrivains chez lesquels l’homme et la femme façonnent, bouleversent leur environnement, s’en mordent ou pas les doigts, ceux où la nature et les humains ont des coexistences plus rudes comme dans pratiquement tous les livres d’Emmanuelle Pagano, ceux de Maryline Desbiolles (je pense à Anchise mais aussi au très beau Rupture sur le barrage de Malpasset).
Et à cette longue liste il faudrait ajouter une autre catégorie d’écrivains dont le rapport à la nature, disons plutôt à l’extérieur, m’a marqué. Ceux qui se déplacent, arpentent. Gracq pour ce regard plus froid sur le paysage, peut-être plus méticuleux, celui d’un géographe qui arpente et qui prend des notes, mais aussi John Muir, Élisée Reclus ou Jean-Christophe Bailly, quand ce dernier musarde, attentif et lent dans Le dépaysement ou dans Une image mobile de Marseille. Cette liste n’a pas de grand intérêt en soi parce que ce sont tous des auteurs connus et reconnus pour leur travail. Mais c’est une partie des auteurs qui m’ont marqué et qui chacun, avec une langue, des tournures particulières pour raconter, sont des écrivains du paysage dans un sens large, des écrivains qui s’y attachent, qui s’y arrêtent, qui s’ils ne font pas nécessairement un personnage du paysage, lui donnent une importance forte.

Thomas Giraud, © Jérôme Blin
Vous vous concentrez sur deux personnages : Considerant, l’intellectuel qui ne prend pas la mesure de la réalité, et Leroux, qui a l’expérience de la terre. L’opposition contribue à structurer le livre : comment cette forme s’est-elle imposée ? Que permet-elle de dire sur Considérant qu’un essai –ou un travail universitaire– n’aurait pas pu mettre en lumière ?
T. G. : Je me suis beaucoup documenté, ai lu à la fois les écrits de Considerant et ce qui a été écrit sur lui, par exemple l’excellente biographie de Jonathan Beecher. Il était tout à fait évident, dès le début, que je prendrai des libertés avec la manière dont ce projet Réunion, au Texas, s’était déroulé. Ce qui m’intéresse dans ce projet n’a pas vraiment de réponse dans les analyses que l’on peut lire de cette expérience. Ce sont d’ailleurs des questions qui auraient pu concerner d’autres expériences de vie collectives. Comment se façonne, se construit cette chose un peu folle, cet orgueil dans le bon sens du terme (c’est-à-dire un mélange d’obstination et de fanfaronnade certainement) de vouloir construire une ville nouvelle, pour mener une nouvelle vie. Ensuite comment ou pourquoi reste-t-on prisonnier de ses propres plans, comment est-on un architecte de papier ? Sur le pourquoi, j’avais déjà ma petite idée qui dépasse largement le cas Considerant dans mon livre. En général, quelqu’un qui a énormément travaillé sur un projet, qui a pesé le pour et le contre, qui a pensé au passé et au futur, qui a organisé les détails et les grands principes dans une logique presque mécaniste destiné à produire le meilleur système possible est en général réticent à remettre en cause autrement que pour des choses vénielles son projet. Ce n’est pas un projet politique que j’ai voulu critiquer, je n’ai pas fait un livre moral. Pour moi c’est presque une farce. Tout est pensé, je pense d’ailleurs, plutôt bien pensé par Considerant mais l’essentiel, le lieu, lui, est choisi avec une totale impréparation. Et ce qui nous saute aux yeux aujourd’hui, qui a dû aussi un peu le travailler, il semble avoir du mal à l’admettre. Et puis pour le comment, cette chaîne de causalité incertaine, j’ai essayé avec mes propres intuitions d’imaginer une histoire possible.
Et un peu comme chez les auteurs que j’ai évoqués plus haut, je trouve important de ne pas forcément regarder ce que tout le monde regarde. Pour simplifier, on regarde en général Réunion pour ce qu’il a été, un fiasco et on s’arrête là ; or, il me semble que dans ce petit désastre, il y a à la marge des évènements moins sombres, des trajectoires, comme celle de Leroux, que Réunion et donc, en creux Considerant, a permis. Il n’était pas vraiment question de les opposer, d’ailleurs, il n’y a pas vraiment de rencontres entre les deux dans le livre. Mais chacun a une perception différente de ce qui se passe ou de ce qu’il y a à prendre dans ce qui se passe. C’est la pluralité des regards. Une expérience a beau être collective, très vite les raisons qui nous font tenir ensemble bougent, se déplacent, changent même. Ce qui nous portait les premiers jours ne nous porte peut-être plus ou en tout cas plus de la même façon.
L’opposition entre Leroux et Considerant ne s’est pas imposée tout de suite. Au départ je souhaitais que le lieu soit le personnage principal du livre, comme Hélène Gaudy l’a fait dans son très beau Une île, une forteresse sur Terezin. J’avais en tête que le livre serait la construction et la déréliction ensuite de Réunion, et que tout se fasse à travers les sentiments et perceptions de nombreux personnages. Deux ont finalement émergé dans cette petite foule que je construisais. Et plus je relisais, plus je retravaillais le texte, plus Leroux a pris de la place. J’aime chez lui la façon de regarder à la fois les choses comme elles sont mais sans se priver d’un regard de biais, une sorte à la fois de fatalisme pragmatique et de débrouillardise.
Votre livre pose la question de pouvoir, ou de l’impuissance, des idées à changer le monde. L’utopie se heurte à la réalité de la nature : la pauvreté des sols, l’invasion des sauterelles, …. Peut-on y voir l’expression d’une méfiance envers cette tendance (française ?) qui consiste à penser que le monde peut se plier aux mots… ou aux chiffres ?
T. G.: Au fond, ce sont moins les mots et les chiffres qui sont en cause dans le livre que la vente par correspondance…on est rarement gagnant en achetant des choses de loin, fantasmées. Ce qui vaut pour une paire de chaussures aujourd’hui dont la pointure ne serait pas la bonne vaut pour ces terres que Considerant n’a jamais vu. Je crois aux idées, à des principes que l’on discute et à des mises en œuvre possible que l’on pourrait faire dériver, plus ou moins, de ces principes. Je ne suis pas un partisan d’un monde où tout se résoudrait de manière pragmatique. Les communautés m’ont toujours passionné et je me suis souvent demandé comment ces injonctions paradoxales fonctionnaient entre elles, la recherche de liberté et l’organisation ? Comment fait-on pour que ça marche ? Et à quoi renonce-t-on si ça ne marche pas comme prévu ? Considerant, mon Considerant, celui avec lequel j’ai pris beaucoup de liberté est surtout un homme de systèmes logiques. Il s’agit d’organiser tout presque comme une machine. C’est un système vertical pensé par un seul homme, qui, à mon sens, pour ce projet n’a pas été confronté suffisamment à la contradiction. Il me fait penser beaucoup aux constituants de la fin du XVIIIème siècle qui par une certaine organisation du pouvoir attendent des résultats concrets. Mais ceux-ci, au moins au départ, étaient assez modeste dans leur ambition : il s’agissait seulement d’éviter le despotisme, Pour ça, il fallait séparer les pouvoirs et tout faire pour que ces pouvoirs ne puissent jamais être entre les mains d’un seul homme.
Ce n’est en tout cas pas l’impuissance des idées à changer le monde que je mets en avant mais peut-être la limite des mots quand on attend d’eux certaines conséquences. J’ai voulu insister sur l’idéologie un peu naïve aux termes de laquelle certaines phrases, en particulier une fois qu’elles ont été écrites, devraient nécessairement entraîner certains comportements. Cette fonction prescriptive des mots ne marche jamais. En revanche, on a besoin des mots pour décrire, même en inventant, même en imaginant. Et cette fonction-là des mots, j’y crois !
Malgré l’abondante documentation que vous intégrez, vous construisez prioritairement votre roman autour des impressions ressenties par vos personnages. Pour autant, le paysage de Texas ne fait pas l’objet d’une attention particulière : vous semblez tenir la description à distance. Était-ce un choix délibéré ?
T. G.: Lors des recherches que je faisais sur le lieu de l’implantation de la communauté de Considerant au Texas, dans cet espace qui a aujourd’hui été absorbé par Dallas, je suis surtout tombé sur les textes de Considerant qui ne s’y était pas encore rendu et qui rêvait cet endroit. À le lire, c’était une des parties du monde les plus fertiles ou les pluies et le soleil s’équilibraient de la plus harmonieuses des façons. Je fais allusion dans le livre à ce qu’il espérait mais j’ai surtout insisté sur le sable, ce qui ne poussait pas, les serpents et les sauterelles…
Le roman avance essentiellement comme vous l’avez indiqué à travers les impressions des personnages. Il n’y a pas ou presque pas de dialogue qui fasse avancer l’histoire. C’est la confrontation de chacun avec ce qu’il vit avec les autres, avec ce qu’il trouve sur place. Je n’ai pas abordé globalement le paysage du Texas, j’ai surtout insisté sur ce que chacun voyait et percevait. La terre sèche, crayeuse, le sable, les arbres qui ne poussent pratiquement pas. C’est un paysage souvent à vue d’homme, sans grande perspective et, je le réalise en répondant à votre question, un paysage qui serait celui que l’on a quand on regarde à ses pieds, peut-être à 45° mais pratiquement jamais vers le lointain. La confrontation avec le paysage est plutôt ingrate dans Le bruit des tuiles. C’est le paysage de gens mis en mouvement, déplacés, incertains d’être là pour longtemps. Il y a peu de moments de contemplation, à part à la fin, avec Leroux, lorsqu’il s’installe vraiment.
Lenteur, simplicité et liberté sont des principes importants pour les colons. Comment ces préférences résonnent-elles aujourd’hui sur la toile de fond de l’écologie, qui les met elle aussi volontiers en avant ?
T. G. : Lenteur, simplicité et liberté sont trois principes importants qui résonnent chez les colons certainement pour ce que j’y ai moi-même imaginé, ce que j’ai emprunté à d’autres communautés que j’avais un peu étudiées : Longo Maï, Monte vertità, les clairières anarchistes (qui a fait l’objet d’un livre précieux d’Anne Steiner, Les en-dehors) ou simplement les communautés imaginées comme Utopia. Si je ne doute pas de l’aspiration à la liberté de ces hommes et femmes du XIXème, d’une volonté de s’attacher à des choses simples et concrètes, je ne sais pas si la lenteur était perçue pour tous, à Réunion, comme une valeur essentielle ; probablement il fallait que les choses soient faites à leurs rythmes mais il devait y avoir pour les colons une certaine urgence, au moins une impatience à ce que tout se mette en route.
Je fais volontiers miens ces trois mots qui me semblent, vous avez raison, résonner fort avec la toile de fond de l’écologie. Même si ce qu’ils impliquent au quotidien n’est pas toujours évident à mettre en œuvre tant les aspirations des uns et des autres ne se recoupent pas. Même allons plus loin, l’envie de simplicité et de lenteur n’est pas également partagée voire aussi pas partagée du tout. De même pour les libertés. J’ai aussi parfois l’impression qu’au nom de ces mots-là, on essaie de nous faire avaler quelques couleuvres…Ces trois principes restent des mots qui, s’ils ont une forte valeur incitative en eux-mêmes, n’impliquent pas un comportement déterminé. Ce qui compte, à la fin, et l’urgence écologique l’impose plus que tout, ce sont les actes.
Pour citer cet article:
Literature.green, Thomas Giraud, « Un paysage aride et l'(im)puissance des mots. La sélection 2020 du Prix du Roman d’Écologie: entretien de Thomas Giraud avec l’équipe Literature.green autour du Bruit des tuiles» in Literature.green, février 2020, URL: https://www.literature.green/un-paysage-aride-et-limpuissance-des-mots-entretien-avec-thomas-giraud, page consultée le [date].
