Des poulets et des hommes
Entretien de Gil Bartholeyns avec Pauline Hachette autour de Deux kilos deux
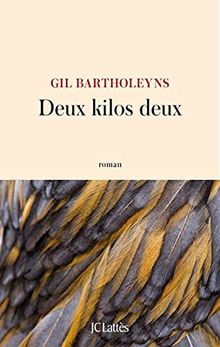
Gil Bartholeyns est historien et écrivain. Il vit à Bruxelles et enseigne à l’université de Lille l’histoire et l’anthropologie. Dans son essai Le hantement du monde – Zoonoses et pathocène (Dehors, 2021), il propose la notion de pathocène pour définir l’ère que nous vivons à partir des troubles majeurs que nous avons introduits dans l’ordre du vivant. Cette ère est aussi celle où nous voyons se déployer à l’échelle humaine « l’expérience ordinaire du monde de l’élevage faite de hantises sanitaires, de biosécurité et d’incapacité à régler les effets secondaires en s’attaquant aux causes premières ».
Son premier roman, Deux kilos deux (JC Lattès, 2019), nous faisait justement plonger, au cœur des Hautes Fagnes enneigées et à la suite de Sully, jeune vétérinaire chargé d’un contrôle dans une exploitation avicole, dans l’affolante logique d l’élevage intensif et les conditions de vie aberrante que nous créons à ces animaux. Ce roman a été finaliste en 2019 du Prix Maya, première récompense littéraire animaliste en France.
Pauline Hachette : Votre roman Deux kilos deux questionne la condition des animaux d’élevage et plus précisément de poulets. Comment vous est venue l’envie d’écrire sur cette question précise et pourquoi avez-vous choisi cet animal en particulier ?
Gil Bartholeyns : J’avais écrit les cinquante premières pages d’un trait. Un certain Sully J. Price arrive dans un restaurant routier des Hautes Fagnes en Belgique, il a rendez-vous pour interroger quelqu’un et une tempête de neige s’apprête à frapper cette région isolée et va tout compliquer. On pense être aux États-Unis parce que sur l’écran de ce diner une autre tempête s’abat sur la côte Est… J’avais cette ouverture et une atmosphère mais je ne savais pas la suite. Je ne souhaitais pas écrire un roman policier. C’est un genre bien à part et je ne voulais pas de crime. Je me suis mis à chercher une raison sociale à ce Sully, la trentaine, peu d’expérience, et qui va devenir le caillou dans la chaussure de pas mal de gens pendant plusieurs jours. Je ne me souviens plus comment j’en suis venu à en faire un vétérinaire missionné pour mener un contrôle dans une exploitation avicole ; un inspecteur vétérinaire fraichement engagé dans l’Unité du bien-être animal, une unité voisine des unités anti-pollution et anti-braconnage. L’air du temps, peut-être. La médiatisation de plusieurs scandales sanitaires et des affaires d’animaux de ferme maltraités ou retrouvés morts par la négligence ou à la suite de la faillite de leur propriétaire. Je me souviens d’un cas de suicide. La compétence du contrôle venait d’être « régionalisée », l’agence fédérale chargée de la sécurité alimentaire ne pouvait donc plus intervenir et cette réorganisation n’était pas sans soulever des critiques parce qu’on échangeait un réseau dense d’inspecteurs agrées avec une très petite équipe en charge de toute une région… J’ai pris contact avec le ministère et j’ai été très bien accueilli au département normatif du bien-être animal. Ensuite, de fil en aiguille j’ai rencontré les représentants des filières au sein des fédérations (autrement dit les lobbies du secteur), jusqu’aux éleveurs sur leur exploitation… Tous les échelons de la filière du poulet, des marchands de nourriture aux manutentionnaires. Et ce que j’ai vu, entendu et senti m’a sidéré. Ce que j’ai compris de la législation, de l’idée du bien-être animal et du système dans son ensemble m’a fasciné.
Au départ, je n’avais donc pas l’intention d’explorer le délire civilisationnel dans lequel et les animaux et les hommes sont pris au piège de l’injonction du vite, mal et beaucoup. Bien sûr ma sensibilité a joué sa part, mais j’ai été « pris » par ce terrain et quand je suis revenu à ma table pour écrire, je ne pouvais plus faire de cet univers un simple décor. Sully devenu vétérinaire ne pouvait plus arriver avec ses certitudes et faire tomber les cartes sur le chemin de la vérité. L’histoire devait basculer du côté des éleveurs. Je devais écrire à parts égales.
Le poulet s’est présenté à moi également sans que j’aie à faire un choix. Le poulet est emblématique de l’élevage intensif. C’est la viande en progression à l’échelle mondiale parce qu’elle est facile à « produire ». Elle est encouragée parce que le taux de conversion alimentaire (l’indice de consommation) des volailles est très bon. Il faut environ 1,4 kilos de nourriture pour faire 1 kilo de poids vif, contre 6 kilos voire plus pour 1 kilo de bœuf sur pied. La déclaration de Cambridge fait des oiseaux « un cas frappant d’évolution parallèle de la conscience », y compris le coq et la poule. Mais ce qui comptait pour moi c’était que ces animaux se retrouvaient à vivre une souffrance physique et mentale du début à la fin de leur très courte vie. Le broyage des poussins et les abattoirs, alors très médiatisés, m’intéressaient moins que ce moment de vie aberrante où la densité de peuplement les blesse, où leur vitesse de croissance les tue de crise cardiaque ou de malformation. Ce sont des chimères. Ils naissent pour ne pas vivre. Pour moi, le fait déterminant n’était pas qu’ils soient intelligents, conscients ou aussi sensibles que nous, mais que, à partir du moment où ils sont réduits à n’être que des corps, c’est par le traitement réservé au corps que s’évalue la qualité d’une existence. Par ailleurs, les oiseaux sont assez éloignés de nous sur le plan phylogénétique et pratique, moins que les poissons, mais plus que le cochon : on ne viendrait pas m’accuser de sensiblerie. Je n’avais pas peur mais je voyais bien dans quel champ miné je mettais les pieds. On l’a oublié mais les poulets – le coq et la poule, pour employer le nom de ceux qui vivent et non de ceux qu’on mange – sont de splendides oiseaux originaires des sous-bois tropicaux d’Inde. Qui le sait ? Cet oiseau que l’on mange sans y penser incarne parfaitement notre déconnexion généralisée avec les autres vivants. Pour le poulet, comme pour tous les animaux d’élevage intensif, tout se passe la nuit. C’est la nuit qu’ils sont transportés et abattus. C’est la nuit que les hommes courent à leurs forfaits gigantesques. Je voulais décrire cette nuit du poulet. Remettre le jour avec la nuit.
P. H. : Vous êtes l’auteur de plusieurs essais dont Le hantement du monde – zoonoses et pathocène (Dehors, 2021) dont les préoccupations recoupent en partie celles de Deux kilos deux. Pourquoi avoir choisi, dans un premier temps semble-t-il, la fiction pour aborder ces questions ? Pourquoi plus précisément, ce mixte entre littérature documentaire et roman d’action des grands espaces?
G. B. : Comme je l’ai dit, ce n’est pas moi qui ai choisi ce sujet, c’est le sujet qui m’a choisi. Je me suis fait cueillir, embarqué. La fiction précédait. J’avais commencé à écrire cette histoire et c’est en cherchant à caractériser le personnage de Sully qu’il est devenu inspecteur vétérinaire. Or je ne savais pas comment fonctionnait une exploitation, un poulailler. Quand vous voulez écrire une histoire qui se passe dans un sous-marin, vous allez sans doute aller en visiter un. Je me suis immergé dans ce monde, j’y suis resté c’est vrai pendant plusieurs mois, mais l’écriture était première. C’est un premier roman publié mais pas le premier écrit. Je n’ai pas utilisé la fiction ou la littérature pour tenir un propos. Je ne me suis pas dit : comment faire passer un message ? Quel pouvoir possède la littérature ? Le livre est un roman de littérature « blanche », publié dans une collection de littérature classique. Comme m’a dit mon éditrice : le style demeure, les sujets changent. Le sujet m’a bouleversé et je ne vis plus de la même façon depuis, mais il est le fait d’une histoire.
Décrire ce monde réputé fermé et opaque, en faire un élément central du récit, s’est imposé en cours de route. Les éleveurs que j’ai rencontrés ne se plaignaient jamais. Pour m’expliquer leur travail, ils me faisaient visiter leurs installations et m’abreuvaient de documents, de chiffres, de normes, d’obligations administratives, de choix techniques à faire ou imposés, de conversion (presque impossibles), d’endettement, d’Europe et de distorsion de concurrence, de glyphosate et de maladies du travail (non reconnues), de contrôles indigents et de crainte sanitaire. J’ai fini par me rendre compte que pendant tout ce temps, le libre arbitre, la colère, le souci de bien faire étaient mis à l’écart, rendus impossibles. Pas le temps, pas maintenant. Et je me suis dit : c’est ça l’expérience de l’aliénation. Comme je l’ai dit ailleurs, j’aurais pu me passer de ces aspects bureaucratiques et techniques. J’aurais pu m’en tenir à un conte d’épuisement et d’effroi où les drames surviennent du fond des âges. Cela aurait été beaucoup plus simple. Des emprises seulement sociales, familiales, conjoncturelles. Mais j’aurais raté l’essentiel : ce qu’est un système d’exploitation. Et puis il s’agit d’un univers d’agronome, d’ingénieur, de médecin. Ils connaissent leur affaire. Ils parlent avec des éléments de langage. Si bien que les réflexions et les paroles contiennent effectivement une certaine dose de technicité. Ce n’est pas un effet d’érudition de ma part mais la traduction d’un quotidien intérieur et relationnel obsessif. Chaque milieu possède sa poétique. Ici on parle de démarrage, d’engraissement, de finition. On parle de lot, de cycle, de vide sanitaire. On parle de desserrage, d’animaux réformés, de spéculation animale… Les mots en disent longs. Je crois que tout écrivain goûte ces décalages d’altérité.
Le mixte, comme vous dites, entre littérature documentaire et roman d’action des grands espaces, résulte simplement de ce réel hypnotique, conjugué au point de naissance du roman qui est cette atmosphère des hauteurs belges entre Allemagne et Luxembourg brusquement percluses de neige.
Le Hantement du monde recoupe le roman parce que cet essai a été écrit au printemps 2021, à partir d’une même familiarité avec la traite des animaux et les zoonoses. Lorsque la pandémie a commencé, j’ai compris qu’on s’apprêtait à faire, à grande échelle, l’expérience ordinaire du monde de l’élevage faite de hantises sanitaires, de biosécurité et d’incapacité à régler les effets secondaires en s’attaquant aux causes premières. L’anthropologue Frédéric Keck avait d’ailleurs établi ce lien avant moi en écrivant sur mon roman dans la revue Esprit et dans son livre Signaux d’alerte, comme un exemple de roman sentinelle.
P. H. : Dans votre roman, cet animal-matière qu’est le poulet est rarement décrit, il est avant tout converti en une multitude vertigineuse de chiffres : masse, poids vif et poids consommable, taux de conversion, vitesse de croissance, heures de jeûne avant le transport, etc. Tous ces calculs contrastent avec quelques moments d’épiphanie de vie, telle la naissance d’un veau. Ces chiffres, comme le prolifique appareillage technologique que vous décrivez, figurent-ils des sortes d’opérateurs magiques réalisant la conversion ontologique permettant de différencier essentiellement ces animaux de ceux que nous choyons au cœur de nos foyers ? Ils semblent cependant différer des ritualisations de chasseurs évoquées par ailleurs.
G. B.: Je décris le poulet, en fait la masse des poulets au cours de l’inspection, mais dès le titre c’est le processus de chosification qui se déclare. Deux kilos deux est un point d’abattage moyen. Les êtres sont des quantités. Ils ne sont pas comptés en nombre d’individus mais en kilos par mètre carré. La législation européenne traduite dans les droits nationaux autorise l’éleveur à passer de 33 kg au mètre carré à 42 kg (soit environ 21 animaux par mètre carré), si ses résultats ne dépassent pas un certain taux de mortalité, au sein d’infrastructures qui permettent une atmosphère régulée en termes de température, d’humidité, de ventilation. C’est cela un « bon éleveur » selon la loi. Le bien-être devient un rapport d’équivalence admissible entre le nombre de morts et le nombre de restés-en-vie. La mort n’est pas à éviter mais à administrer. C’est pourquoi on peut dire que le biopouvoir trouve dans l’élevage industriel sont accomplissement le plus parfait. Si les conditions de vie d’une population comptent, c’est seulement dans la mesure où elles altèrent sa rentabilité. J’ai écrit dans la revue Terrain (« Le formule de la chimère ») sur ces aspects de gestion de la morbidité systémique.
Quand on est devant un océan de poulets, il est impossible d’avoir un rapport individuel avec eux, et pourtant ce sont des individus. Ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas non plus des personnes, ce sont des individus. Ce mot permet peut-être de traverser les lignes de débat antispécistes, éthiques et légalistes. Littéralement, un individu est indivisible. C’est une bonne définition du vivant. Cela peut valoir pour un territoire, pour une rivière. L’animal est inscrit dans le droit en tant que bien, mais depuis la seconde moitié du XIXe siècle ce statut tend à se diversifier à travers la constitution de trois régimes juridiques bien distincts : celui des animaux de compagnie (apportant protection contre la mort volontaire et la maltraitance), celui de la faune sauvage (concernant la chasse, le braconnage et le commerce illégal) et celui de l’animal de chair ou de rente, animal longtemps oublié et désormais repris dans une série de règlements normatifs qui consistent essentiellement à limiter les dégâts. Au cours des décennies, le bétail a subi la transformation radicale que subit tout chose au contact de l’industrialisation, au point d’être désanimalisé : les animaux d’élevage sont transformés en « machines à faire de la viande, des œufs et du lait », des machines susceptibles d’optimisation jusqu’à une limite fixée en termes de bombe sanitaire. Les trois genres d’animaux (sauvages, compagnons et exploités) se sont établis dans le temps long, à travers le développement respectif des sciences productivistes à partir de la fin du XVIIIe siècle, des grandes ménageries et réserves (de chasse) africaines, et des mouvements de protection, signe et moteur d’une évolution des sensibilités (la Société protectrice des animaux est créée en 1846). On peut même dire que la péjoration (objective) des animaux de rente est allée de pair avec la valorisation (subjective) des espèces compagnes. Le roman ne fait qu’exhumer ce partage du sensible.

Gil Bartholeyns
crédits photo: R. Fakouri
P. H. : Au milieu de ce grand blizzard qui enveloppe personnages et paysages, on peut se demander avec quelle lumière se diriger. Sully, le jeune vétérinaire, mais aussi Frederik le dirigeant de l’exploitation agricole, se perdent dans des dédales argumentatifs intérieurs ou adressés. Les logiques financières comme sanitaires ont des allures de folie, la logique du bien-être devient aisément paradoxale, comme le montre la comparaison entre élevage intensif et bio. Aucune base ne permet d’ériger de préceptes moraux partageables. Sur quoi se fonder pour s’orienter semble être une question posée par le roman ?
G. B. : C’est vrai : impossible de sortir de là par la morale. Cette impossibilité de se tirer d’affaire par les valeurs respectivement engagées par les uns et les autres – les éleveurs, le marché, les jeunes, les enfants, le vétérinaire, Paul le patron du diner, les clients et tous ceux qui ont maille à partir dans cette affaire – était très importante à conserver pour moi. Comme l’a dit joliment un journaliste : « la justesse, plutôt que la justice ». Si on s’en prend aux personnes, on rate le coup, car il s’agit d’un système qui ne laisse rien ni personne indemne. L’outrage est collectif et c’est précisément ce qui lui permet de se maintenir. Il s’agit d’une institution. Dans nos sociétés, ce n’est que dans ce cadre que l’on peut tuer : à l’armée et dans l’élevage. Si la violence est personnelle, il s’agit de maltraitante et la maltraitance envers les animaux est punie par la loi. Si on dit que l’élevage est cruel, on rate le coup, car l’acte de cruauté est un écart, tandis que la violence de l’élevage est instituée. Si on dit que les lois sur le bien-être animal, c’est-à-dire les « normes minimales » dans les élevages sont hypocrites, on rate aussi le coup. À ce point, c’est moi qui à travers le roman et le personnage de Sully prend position. Cela n’engage que moi et je le fais à partir d’une sorte d’au-delà, hors argumentation. C’est ce que j’ai éprouvé et je cherche donc ces moments dans le roman où Sully est noyé de larmes et sa raison débordée par quelque chose de plus profond. « S’il était dans cet état pour des poulets, c’est qu’il devait partager quelque chose avec eux, quelque chose d’eux, comme il partageait, par-delà le temps, quelque chose avec les charniers, les incendies, les exécutions sommaires, une sorte de continent archaïque, dense mais impalpable, immense et invisible qui s’imposait à son propre corps. Car ce n’était pas la raison qui pleurait en Sully J. Price en ce moment. Ce n’était pas elle qui n’avait pas pu tenir le coup. » « Tant d’années s’étaient écoulées avant qu’il comprît que la vérité était plus utile aux opprimés qu’aux tyrans, et que la bonté ne serait pas réarmée à leur contact mais à celui seul des bêtes. Quel sortilège avait-on jeté sur le monde ? En deçà de la pensée et au-delà de la société, se rappela-t‑il énigmatiquement, voilà le seul contrat digne d’être passé avec la vie. »
P. H. : La sensibilité elle-même est sujette à caution et vous lui faites subir un renversement brutal : non seulement l’apprentissage vétérinaire s’apparente à un processus de désensibilisation par la « dévaluation des impressions » premières, mais Sully, face aux actes de cruauté qu’il découvre, se trouve bouleversé non par l’insensibilité des hommes qui les pratiquent mais par le fait qu’ils révèlent des individus plus sensibles que, « à l’autre bout du désastre », les raisonnables exploitants, fût-ce sous la forme d’une « empathie négative ». Quel statut donnez-vous à cette sensibilité ?
G. B. : Ce renversement est un des arcs narratifs, presque métaphysique, de l’histoire. Sully arrive pour une inspection. Il y a eu des plaintes. On pense logiquement qu’il va découvrir une misère d’élevage, des animaux maltraités. Rien de tel en réalité. Au contraire, l’élevage en question est un modèle. Mais justement : on y découvre un enfer modèle. Sully y est habitué. Il constate la quasi-perfection de cet enfer, sa conformité. Il se demande à quoi tiennent les plaintes… Ce qu’il va être amené à découvrir va le renverser. Je ne veux pas trop en dire, mais ce qui va lui faire quitter sa réserve de fonctionnaire c’est « bêtement » la cruauté imbécile de certains. Il ne s’y attendait pas, mais ce choc auquel il ne s’attendait pas met en train chez lui un raisonnement nouveau qui peut déranger. Au fond, se dit-il, celui qui fait du mal à un animal est plus proche de celui qui le chérit que de celui qui l’abat. Le tortionnaire s’en prend à un animal parce qu’il reconnaît encore une capacité à souffrir. Pour lui, comme pour l’ami des bêtes, l’animal est un être sensible. L’abatteur, lui, s’il fait bien son boulot, reste insensible. Il n’éprouve ni aversion ni plaisir. Pour lui, l’animal n’est plus rien.
P. H. : Vous parlez par ailleurs de ce régime affectif qui est devenu le nôtre et vous développez notamment la notion de Pathocène. Les personnages de votre roman en sont-ils des représentants ?
G. B. : Le Pathocène a été pour moi une façon de qualifier notre temps sous l’angle de la maladie, et singulièrement des maladies industrielles et capitalistes, et d’en faire la généalogie. Cela comprend notre attitude « pathétique » face toutes sortes d’événements immenses comme l’effondrement de la biodiversité ou le dérèglement climatique, et pas seulement la pandémie qui a catastrophé le monde à partir du printemps 2020. Sully J. Price, vétérinaire et personnage principal du roman, est bien une figure du Pathocène. Les animaux sont malades des hommes et les hommes sont malades des animaux. Il se trouve à l’interface. Sully fait tout ce qu’il peut dans la mesure du cadre légal qui est à la fois un moyen d’action et l’impossibilité d’agir comme il faudrait. Dans les filières viandeuses, un vétérinaire ne soigne pas, il contient des maladies qui sont reconnues comme systémiques aux élevages. Sully en Pathocène, je n’y ai jamais songé parce que Le hantement du monde n’était même pas en projet quand le roman est paru. Paul, le patron du diner où Sully arrive et qui deviendra un des lieux clés de cette histoire, est lui aussi une incarnation de cette ère de contradictions et de normes à tout faire. Il roule en Hummer mais il s’est fait construire une maison passive au fond de bois. Il assouvit le désir d’Amérique du Nord des clients du Pappy’s avec des pilons de poulets délicieux, mais il préfère pêcher la truite entre les rochers en bas de chez lui et il se passionne pour la réintroduction de l’écrevisse à pieds rouges, décimée par une sorte de peste venues des États-Unis dans les années 1890. Le Pathocène est fait du drame de l’irréversibilité des phénomènes : l’état pathologique n’est pas une variation mais une autre dimension. L’anthropisation des paysages est à ce titre exemplaire. Les hauts plateaux fagnards en forme de marais passent pour naturels, alors que ce paysage de toundra est tout à fait adultérin. Il a été produit d’abord par le déboisement intensif à destination de l’industrie métallifère (on transformait les arbres en charbon pour en faire du combustible pour les nombreuses forges), ensuite par la suractivité pastorale. L’ironie géographique est totale parce que les défenseurs de cette réserve naturelle officielle se battent désormais contre la reforestation spontanée des feuillus pour maintenir une flore et une faune en effet tout à fait particulières, de type boréal. On y trouve par exemple des tétras-lyres, un coq de bruyère. Il apparaît à la fin du roman. Invisible mais Sully entend son cri caractéristique « tiououiich, tiououiich… » dans la solitude hivernale. Il s’ébat sous la protection des autorités vertes pendant que son cousin se fait assaisonner au Pappy’s en pièces détachées. Paul le contrasté donne dans le concours du meilleur viandard mais dans la contemplation. Pour lui rien n’a son pareil en splendeur que la forêt. Mais quelle étrange forêt ! Tout y est violent et paisible à la fois. Les pousses tordues par le gel, les plantations de sapins mises à blanc… Il se demande comment une telle arrogance peut être à ses yeux si reposante. Comment la beauté semble toujours sublimer le saccage.
P. H. : Quelle place avez-vous voulu donner à l’environnement en situant cette histoire dans un lieu précis, les Hautes Fagnes en Belgique, et dans un moment caractérisé de déchaînement météorologique qui entrave mais aussi semble pousser l’action ? Au-delà du fort potentiel esthétique et atmosphérique de paysage blanc – on pense à un western comme La chevauchée des bannis – on peut penser que s’y dessine une opposition entre ces animaux-objets et des éléments apparaissant maîtres de l’action humaine. Cette neige, n’a-t-elle pas aussi une capacité de hantement certaine ? Elle peut garder aussi bien qu’effacer les traces.
G. B. : Je connaissais la région. J’y menais une enquête de terrain qui n’a aucun lien avec le sujet qui s’est imposé à moi dans ce roman. J’y allais seul et je sillonnais les villages, les collines boisées. Il m’est souvent arrivé de rouler par temps de neige, de m’arrêter pour regarder autour de moi. De me surprendre à écouter le vent, à regarder une voiture passer, à enregistrer des traits régionaux. Finalement tout cela crée en vous un espace à part et vivant qui se poursuit dans l’imaginaire. Quand vous êtes seul quelque part, certains lieux deviennent des phares au milieu du vide. Mais c’est un roman faussement localiste parce que même si tout est précis, le virage, le chemin d’accès ou la rivière, le restaurant routier n’existe pas, l’hôtel n’existe pas, les personnages n’existent pas et il n’y a aucun élevage de ce genre dans la région. Les seules lumières du roman sont réelles, une maison de hameau, des phares de pickup. Sully traverse des ténèbres blanches et en les traversant, il rencontre l’amour – amour dont il ne se croyait pas capable, amour qu’il ne croyait pas possible dans ces circonstances incertaines voire dangereuses. C’est par là que s’ouvre le roman et c’est par là qu’il se referme. Ce n’est pas une clause romanesque. Il y a l’être et le non-être, mais il faut ajouter que dans le non-être il y a encore de l’être. Surtout, il y a de la grâce. Je n’ai pas tellement de distance sur ces éléments environnementaux. Ce serait cadrer l’élan au fond très simple qui, par envoûtement, m’a fait écrire cet ici et maintenant. J’aime la neige, le silence qui se fait quand il neige, sa lenteur visuelle, sa rapidité à tout métamorphoser, ses variations de lumière, l’effet du froid sur les hommes et le repli qu’il impose. À conditions (hivernales) extrêmes, comportements (potentiellement) extrêmes. Ça c’est un dispositif dramatique. Mais il n’était pas prémédité. L’élément neigeux a d’abord été un défi d’écriture, et la nécessité de ne pas perdre cet élément en cours de route – car il neige de plus en plus, il fait de plus en plus froid, il est de plus en plus difficile de s’orienter, de trouver du secours – est devenu une nécessité pour la progression contrariée des événements normaux. Pour Sully : mener le contrôle de l’exploitation, plus tard échapper à ses poursuivants. Pour l’éleveur Frederik Voegele : faire venir le transporteur car il est en fin de « ronde » et ses poulets ne vont pas tenir le coup s’il les garde plus longtemps ; ils vont continuer à prendre du poids, même s’il les met dans l’obscurité pour qu’ils dorment et arrêtent de manger, et leurs affections (dermatites, locomotion altérée, cannibalisme) vont s’aggraver rapidement. La neige qui bloque tout risque de pousser le système concentrationnaire à la faute, et Frederik au pire. Les animaux sont sous le joug du temps humain et les humains sous le joug de leur entreprise délirante. Il y a donc une force narrative des intempéries mais cela s’est mis en place dans le mouvement de l’écriture qui suit le mouvement de Sully qui conduit l’enquête ou plutôt qui se fait conduire par elle. Plus tard, lorsqu’il a fallu trouver les mots pour parler du roman, j’ai parlé de « western blanc » et cela a été repris. Il faut des images. Fargo est venu à l’esprit des journalistes. Le sentiment de bout du monde du Rivage des Syrtes aussi. Et les frères Dardenne, sans doute parce que je suis belge et que j’ai dit quelque part que j’ai été l’élève de Luc Dardenne. Mais je me suis surtout confronté à la neige littérairement. Je le dis parce que je me suis rendu compte d’une sorte de prolongement. Dans le roman que je viens de terminer, je me confronte au feu. À son boucan, sa menace, son caractère également sublime au sens kantien. Effrayant et sacré. Ce qui est commun à ces éléments ce sont les paysages. Être paysagiste est une des choses les plus hautes et difficiles en littérature, en poésie, parce que c’est sans doute la forme la plus achevée de l’intériorité.
P. H. : Dans la conversation spontanée qui suivait un entretien avec l’auteur d’un essai récent sur la chasse, celui-ci nous avait fait la remarque : c’est étrange, sur ce sujet on en arrive toujours à parler des enfants. C’était en effet le cas, et pourtant ils n’étaient pas présents dans son essai. Dans votre roman, on finit aussi par parler des enfants. Du petit Louis qui ne veut plus manger d’animaux, de la mort accidentelle de Gaspard qui laisse un trou insondable, de son père qui n’en pouvait plus de donner la mort dans une usine de transformation et de sa rédaction, enfant, sur une poule tuée avec son propre père. L’enfant nous invite-il à porter un regard singulier sur cette opaque affaire d’animal et de mort ?
G. B. : On est enfant avant d’être adulte et on repasse par là en ayant soi-même des enfants. Je ne sais pas à quel titre Charles Stépanoff vous a dit qu’on finissait toujours par parler des enfants en parlant de chasse ou d’élevage. Mais c’est vrai que le cœur de Deux kilos deux est peut-être moins l’élevage proprement dit que Léa (la serveuse du Pappy’s), ses enfants et le drame familial qu’ils traversent quand Sully les rencontre. Louis, l’ainé, a six ans et en effet il ne veut plus lier la caresse et le couteau. Son père qui a mis fin à ses jours travaillait dans un abattoir avant de devenir le second de l’éleveur, c’est le lien mais ce n’est pas la raison du refus de Louis de manger des animaux. Au départ, les enfants ne mangent pas des animaux, ils mangent de la viande. Il faut donc leur dire que la viande c’est des animaux. Une fois qu’un enfant sait cela, il dit souvent que ce ne sont pas les mêmes animaux, ceux qu’on mange et ceux qu’il a vu plein d’émerveillement à la ferme ou dans la prairie. Une fois qu’on lui a dit que c’étaient les mêmes, il va dire qu’on les mange une fois qu’ils sont morts. À chaque étape il essaye de réduire son trouble. Il faut alors lui dire qu’on les tue pour les manger. C’est là qu’intervient généralement le chasseur, très présent dans l’esprit d’un enfant. Alors il en veut beaucoup aux chasseurs. Il dit qu’il les déteste. Il n’a pas l’idée de l’élevage. On peut lui expliquer mais ce n’est pas facile car on se rend compte alors de l’énormité de cette réalité. J’ai à peine été surpris d’entendre un jour un enfant me dire : mais on est des animaux, c’est comme si on se tuait nous !
Au moment de cette prise de conscience en escalier, l’enfant arrête souvent de manger de la viande, mais comme à l’école ou dans la famille on continue à en manger, il en remange, il n’y pense plus, et il devient adulte. Je me souviens que mon père coupait les guêpes et écrasait les fourmis qui s’aventuraient sur la table du petit déjeuner l’été. Il le faisait sans y penser. En écrivant, j’ai repensé à cette culture générale et à ses effets. Comme je parlais beaucoup, à cette époque, de ces questions, j’ai recueilli un grand nombre d’histoires. Un ami m’a raconté une anecdote que j’ai reprise. Je ne sais pas ce qu’il reste de la vraie histoire, quand elle commence et où elle finit, mais c’est José, le père disparu, qui l’a vécue enfant et il y pense tandis qu’il réalise son triste travail dans l’usine de transformation : en classe, pour un exposé, le petit José avait choisi de raconter comment il avait tué la poule avec son père, comment elle avait couru sans tête et comment ils l’avaient mangée le dimanche, sans rien en laisser parce qu’il avait compris que la poule avait tout donner, et comment, après avoir partagé son obscure émotion en classe, ses camarades l’avaient traité de monstre, et il s’était demandé si c’était vrai, plus personne n’avait voulu joué avec lui, puis les vacances avaient effacé l’épreuve de la vérité et son effet miroir, et tout était rentré dans l’ordre. Je ne sais pas comment faire pour que les choses ne rentrent pas dans l’ordre.
Pour citer cet article:
Gil Bartholeyns, Pauline Hachette, « Des poulets et des hommes. Entretien de Gil Bartholeyns avec Pauline Hachette autour de Deux kilos deux » in Literature.green, avril 2022, URL: https://www.literature.green/des-poulets-et-des-hommes-entretien-de-gil-bartholeyns/ , page consultée le [date].
