« Casser les mots pile à la pliure de l’oubli »
Entretien d’Antoine Wauters avec Hugo Zwaenepoel autour de Moi, Marthe et les autres
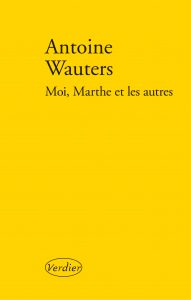
Antoine Wauters est un poète, scénariste et romancier belge. Son premier roman Nos Mères (verdier, 2014) a été récompensé par le « Prix Première de la RTBF » ainsi que par le « Prix Révélation de la Société des Gens de lettres. »
En 2018, il publie deux autres romans, toujours chez Verdier : Pense aux pierres sous tes pieds (Prix du deuxième roman) et Moi, Marthe et les autres. Dans ce dernier texte, nous découvrons une poignée de survivants d’une catastrophe. Ils ont tout perdu, ou presque …
Hugo Zwaenepoel : Avec Moi, Marthe et les autres vous vous inscrivez dans une longue tradition littéraire de romans d’anticipation basée sur des scénarios postapocalyptiques. On pense à La Route de Cormack McCarthy, ou encore à Ravage de René Barjavel. Même si dans Marthe, la nature de la catastrophe reste inconnue, beaucoup de ces récits partent d’une catastrophe environnementale. Y a-t-il des auteurs qui vous ont particulièrement marqué en ce sens ?
Antoine Wauters : Pas tant que ça, non. Quand j’ai écrit Marthe, j’étais moi-même une sorte de catastrophe naturelle. Ma vie venait de voler en morceaux et, quoi que je fasse, j’évoluais dans un monde postapocalyptique. C’est donc en regardant mes propres ruines que j’en suis venu à écrire ce livre. Ceci dit, mes ruines ont rencontré les grands enjeux écologiques et les questions qui nous traversent tous pour le moment : comment vivre ? Comment espérer ? À quoi s’accrocher quand plus rien ne tient ni ne fait sens ? Ce que je crois, et ce qui s’est passé avec ce livre, c’est que j’ai senti qu’entre les états du monde et ma réalité intérieure, entre l’état assez désespérant du monde et mon état assez désespéré, il y avait une connexion étroite. Quand le monde souffre, on souffre aussi. C’est comme ça. Ce sont les mêmes maux, mais intériorisés. D’autres grands incendies, d’autres bateaux qui sombrent, d’autres réchauffements, d’autres tsunamis. J’ai écrit Marthe de cette façon. Il y avait mon chaos et le chaos du monde, et l’un et l’autre se donnaient la main. Écrire, c’est être contaminé. On pourrait être contaminé par la joie du monde, mais les temps n’étant pas à la fête, on est contaminé par sa douleur et on a mal aux arbres, aux animaux et à l’avenir lui-même, et notre travail, en tout cas le travail tel que je le conçois, c’est de trouver le moyen d’en guérir, oui, de guérir en soi cette douleur du vivant. Pour écrire Marthe, je n’ai fait que ça. Je me suis penché sur le mini-théâtre de mes nerfs, où se rejouait avec grande précision ce qui se tramait dehors. Et j’ai essayé d’amener un peu de lumière au milieu de tout ça… Bien évidemment, j’ai sans doute eu en tête des lectures passées. La Route de McCarthy, c’est sûr. Mais à aucun moment, je ne me suis dit que je faisais de la littérature, et encore moins que je m’inscrivais dans une histoire de la littérature. Ce que j’ai fait, c’est commenter le monde tel qu’en mes nerfs, c’est dire les effondrements que j’y sens. En fait, j’ai écrit un livre qui parle de ce que les mots ne peuvent pas conserver, de ce que la littérature à elle seule ne peut et ne pourra pas sauver. J’ai raconté le sol, le ciel, la terre et les forêts.
H.Z. : Il est difficile de ne pas lire dans Moi, Marthe et les autres un avertissement. Selon vous, quel rôle peut jouer la fiction dans la prise de conscience du plus grand nombre, notamment dans le contexte actuel de la crise environnementale, et quels sont ses atouts quand on la compare à l’essai ou à la publication scientifique, par exemple.
A.W. : Vous avez raison. Il y a sans doute un avertissement dans ce livre. Je crois qu’on est allés trop loin, qu’on a vécu comme si tout devait durer toujours, sans remettre en question nos modes de vie, nos modes de production et de consommation, y compris de denrées culturelles (dans quelle mesure n’est-on pas coupables d’écrire et publier des livres qui, si souvent, font comme si la crise climatique n’était pas un problème ?). Ce que je veux dire, c’est que quand on vit en pensant que tout peut durer toujours, on ne vit pas ; même si on ne le voit pas, on est en train de mourir. Marthe, c’est le premier livre que j’ai écrit en me disant que les mots que j’étais en train de tracer pouvaient disparaître à tout moment. Non pas disparaître de la mémoire des gens ou de l’histoire de la littérature, mais de la terre elle-même, de la surface de la terre. Quelques degrés de plus, quelques Trump de plus, et hop, il n’est pas impossible que tous nos livres et toutes nos productions culturelles se retrouvent à la poubelle. J’aimerais penser que des livres comme Marthe peuvent amener des changements. Mais les seuls changements que les livres produisent sont des changements internes, d’infimes variations de lumière dans le paysage de nos humeurs. Un rythme de respiration plus lent, plus profond. N’est-ce pas déjà un grand changement ? Les essais et les publications scientifiques s’adressent à la raison. On peut changer les choses quand on s’adresse à la raison. À une époque où l’« ultracrépidarianisme » (le fait de donner son avis sur des sujets à propos desquels on n’a pas de compétence) règne en maître, c’est sans doute crucial : s’informer, trouver les justes sources, les médias qui aident à comprendre et qui relancent la pensée (ces médias-là existent, mais en marge des autres). Ceci dit, en tant que romancier, je m’intéresse surtout aux imaginations et aux choses qu’on fait sans « raison » : aimer, mentir, espérer, avoir peur, s’obstiner dans l’erreur… Je crois que c’est là, à l’endroit de nos obstinations, que j’ai eu envie de lancer une micro-alerte. Je suis très inquiet de voir combien nous refusons de ralentir, de stopper la machine infernale et combien notre formidable capacité d’adaptation, avec le temps, confine à l’aveuglement. En écrivant Marthe, je me disais en permanence que le climax de nos sociétés, leur plus haut point de « développement », coïncidait en fait avec l’endroit où le serpent se mord la queue. Que notre instinct de survie et notre capacité d’adaptation, sans lesquels je ne serais pas en train d’écrire ces lignes et vous en train de les lire, cessaient peut-être, en ce moment, d’être des atouts pour devenir des choses par quoi viendrait notre fin. Mourir d’avoir voulu vivre à tout prix. Mourir de s’être crû invincibles et d’en avoir constamment voulu plus.
H.Z. : La crise sanitaire actuelle ébranle plus que jamais nos certitudes et ranime nos peurs pour l’avenir. Tout comme votre roman Moi, Marthe et les autres, cette nouvelle situation nous rappelle qu’un scénario catastrophique n’est jamais très loin. Quel regard portez-vous en tant qu’écrivain sur cette crise et son impact ?
A.W. : Au début, j’avais de l’espoir, car de la même manière que la maladie est une formidable proposition de transformation, je pensais qu’on se servirait de ce qui se passe pour changer les choses. Créer de nouvelles solidarités et d’autres alliances avec le vivant. Mais force est de constater que je me suis trompé. On ne crée aucune nouvelle alliance avec personne et nos solidarités, si tant est qu’elles existaient encore, ont volé en éclats. Qui aurait cru, il y a un an de ça, qu’on se trouverait ici aujourd’hui ? De même, qui peut dire où nous serons dans un an ? Cette crise est un révélateur et un accélérateur des problèmes qui nous rongent. La pauvreté explose. On tient le coup en gobant des pilules magiques car la seule chose dont on est sûr, c’est qu’on a peur et que l’avenir lui-même semble masqué. Coincés dans le présent, sans air ni réelles perspectives, on cherche des refuges là où l’on peut. On se réfugie dans le musée de la mélancolie, se repasse le film de notre enfance comme quelque chose de pur et de joyeux, plonge dans les archives de la « Sonuma » et revalorise gestes et savoirs anciens. Toutes les semaines, dans mon entourage, quelqu’un dit qu’il va se mettre au maraîchage ou à l’herboristerie. Des mots qui sont sur toutes les lèvres et qui le sont parce qu’on sent que tout ceci ne peut plus durer et que le remède à cette absence d’horizon passe par un autre grand retournement, en forme d’inversion des valeurs : pour soigner l’avenir, il nous faut du passé, il nous faut les savoirs anciens, des vieux et des ancêtres. On le sent. On sent bien qu’on ne peut plus passer notre vie rivés à des écrans. Qu’on veut reprendre le contrôle sur ce qu’on mange, ce qu’on respire, ce qu’on fabrique et comment on le fabrique, ce qu’on écrit et ce dont on rêve. On ne veut plus être pillé et torpillé par le pouvoir du fric. Ça ne nous rend pas heureux. Les générations précédentes ont peut-être été heureuses d’avoir eu de l’argent. Moi, je n’ai pas d’argent et je n’en veux plus. Si les choses continuent, je crains que les fossés ne se creusent toujours plus : entre riches et pauvres, ceux qui pourront encore quitter les villes et ceux qui s’y trouveront coincés, ceux qui pourront se nourrir et ceux qui ne le pourront plus, mais aussi entre ceux qui voudront conserver un rapport avec la « nature » et un pouvoir d’action sur leur vie et leurs choix, et les autres, qui continueront sur la route actuelle, glissant de plus en plus d’un monde réel vers un monde virtuel amené à le remplacer. Tout ça me fait penser au roman Nous autres d’Eugène Zamiatine. Il date de 1920, mais le « bridage » des libertés, le contrôle de l’information, la mise en algorithmes de nos vies entières et tout ce qu’on est en train de vivre, on le trouve déjà dans ce roman, qui dépeint une société où tout le monde contrôle tout le monde et où la science règne en maître. Avec ce petit détail crucial : Dans Nous autres, si la plupart des gens acceptent leur sort sans ciller, il y a des dissidents qui, n’en pouvant plus du règne de la technologie, sont retournés vivre derrière le « Mur vert », dans la nature. Ce grand schisme, cette cassure entre partisans du régime et dissidents, est à mon avis quelque chose qui ne va cesser de grandir dans nos sociétés. Épuisés de ne trouver ni oxygène ni sens dans cette prothèse de luxe qu’est le virtuel, je suis certain qu’on sera de plus en plus nombreux à vouloir laisser là nos machines. Une sorte de retour au luddisme, de rage contre les machines en même temps qu’une envie impérieuse de retrouver le Mur Vert et une vie de sens et de « lumière ».
H.Z. : L’écriture épurée telle qu’on la découvre dans Moi, Marthe et les autres met en valeur la littérarité de cette œuvre. Victor Hugo disait que « la forme, c’est le fond qui remonte à la surface ». Dans quelle mesure votre style contribue-t-il à faire passer le message concernant ce possible monde apocalyptique, et quels sont les défis d’écriture sur ce plan ?
A.W. : Comme le livre raconte ce qui vient après une catastrophe et que ce qui vient après la catastrophe, c’est la ruine, j’ai voulu faire passer cette réalité dans la forme. Que les ruines parlent. J’ai donc placé le moins de virgules possible et évité un maximum les enchaînements logiques. De même, les paragraphes portent des numéros parce que le narrateur en avait besoin. C’est un type oublieux, le narrateur, un gars perdu, comme nous. Il ne se souvient de rien et avance au milieu d’un monde qu’il ne connait pas. Alors, il parle et il écrit en plaçant des repères numérotés : c’est sa façon de laisser une trace, de placer des cailloux en travers de l’oubli. Depuis quelques années, je suis frappé de voir le recul de la mémoire dans nos sociétés, combien on fixe les choses avec peine et combien elles disparaissent, sitôt parues. On regarde des films qui, dès le générique de fin, rejoignent les centaines de milliers d’images vues et oubliées précédemment. On lit des livres qui s’effacent à mesure qu’on les lit. De sorte qu’on ne sait plus ce qu’on a vu et lu, ni ce qu’il faut dire et faire. On ne sait plus ce qu’on sait. On pense peu. Notre vie consciente et intelligente est, elle aussi, devenue un état d’exception, une rareté. J’ai voulu que tout ça se retrouve dans la forme. Écrire un livre avec les quelques mots qu’il reste quand tout a disparu. Le narrateur, c’est moi. C’est nous. C’est notre peur devant la perte et notre volonté d’avancer quand même. Ce que je voulais faire, c’était casser les mots pile à la pliure de l’oubli. Par exemple, quand je vais dans les vieux greniers de mes ancêtres, je ne sais plus nommer ce qui s’y trouve. Une « dame-jeanne », qu’est-ce que c’est exactement ? Mes ancêtres le savaient. Moi, plus très bien. De même, mon arrière-grand-père était « épinceur », il travaillait comme ouvrier de carrière, ses instruments étaient la « chasse » et la « massette ». Eh bien, tous ces mots sont menacés d’extinction. Autrement dit, si on me plaçait dans le monde de mon arrière-grand-père, ce serait un monde presque « futuriste », tellement je n’y comprendrais rien. Non seulement je serais incapable de nommer les choses avec précision, mais je ferais comme Hardi, le narrateur du livre, je me mettrais à parler le « langage des ruines », faits de restes et d’approximations. De mots amputés, estropiés. J’aimais bien, en parallèle, l’idée que la catastrophe mène à un état primitif où des choses comme le Macdo et Internet semblent aussi abstraites et éloignées aux personnages que, disons, une charrette à bras, une chasse ou une massette. Dans l’oubli, tout se vaut. La catastrophe supprime les strates chronologiques. Elle égalise tout. Le passé ancien et le passé récent. Et tout ce qui subsiste, c’est un présent qui balbutie à la recherche de son propre nom. Je crois que l’idée d’amputer les mots est venue comme ça. Je me suis dit : si tout devait s’arrêter et que seuls quelques enfants devaient survivre, un jour ils se promèneraient dans des rues où nos vieilles enseignes publicitaires seraient leurs seuls et uniques référents. Non plus du « Coca-Cola » mais du « Coc-la ». Non plus les « Galeries Lafayette » mais les « Galafayette ». A bien des égards, on évolue dans un monde où tous les référents sont déjà amputés. Qui sait si Johnny Halliday, dans quelques années, ne deviendra pas le « John Holiways » du roman ?

Antoine Wauters
crédits photo : Lorraine Wauters
H.Z. : Les personnages de Moi, Marthe et les autres vivent sans mémoire du monde ancien, celui d’avant la catastrophe. Dans un sens, nous sommes également déconnectés du monde naturel. Devons-nous conclure que ce contact est à jamais perdu, ou estimez-vous qu’il est possible ou souhaitable de rétablir le contact avec la nature, et si oui, comment ?
A.W. : Je crois qu’on peut encore se connecter à la nature. Mais la nature est devenue une chose impensable, qui recouvre des tas de réalités très différentes. Quand on dit « nature », de quoi parle-t-on exactement ? Quand je vais à la ferme avec mes enfants, on passe beaucoup de temps à observer les vaches. Les vaches font partie de la nature. Mais ces vaches sont des vaches écornées et leur race est le fruit de nombreuses manipulations génétiques. Dans la nature, de telles vaches n’ont jamais existé. Des vaches dont les pis sont conçus pour coller le mieux possible à la traite électrique, où trouve-t-on cela dans la « nature » ? Pourtant c’est ça, la nouvelle nature. Dans les années 80, qui m’ont vu grandir, c’était encore une autre nature. Une nature peut-être un poil plus naturelle, mais plus très naturelle quand même. Ceci dit, il reste un domaine qui peut mettre tout le monde d’accord. Il suffit de plonger les mains dans la terre, quelques minutes suffisent. Arracher des liserons, des ronces, des trèfles. Semer, biner, sarcler. Quand on pétrit la terre comme un pain, alors oui, on se connecte à quelque chose qui ne ment pas. La nature « naturelle », sans fard ni concept. Il faudrait constamment vivre avec les mains barbouillées de terre. On serait plus heureux. Et les pieds nus. Moi, c’est une chose que je dois faire chaque fois que je travaille au jardin. Ça me permet de respirer. Le savoir par les pieds. Le gai savoir. C’est là que je le trouve. Comme le fait que le bonheur est une chose circulaire : quand je travaille la terre, même si ce n’est plus la bonne terre noire de mon grand-père, je renoue avec son bonheur à lui, du temps où il suait sang et eau sur ses plants de pommes de terre. Mes chemises ont la même odeur que les siennes. Mes doigts aussi sentent comme les siens. Que le bonheur est circulaire, qu’il part puis qu’il revient, je l’ai intégré en repiquant des poireaux, en coupant la roquette. Ça a l’air stupide, mais je refuse de perdre ce que mes ancêtres ont mis tant de temps à construire, à apprendre et à développer. Mon travail, c’est de faire en sorte de n’oublier ni leur nature, ni leur culture. Tant que je suis dans le temps de la terre potagère, à répéter leurs gestes, je ne suis pas dans le temps qui me détruit, ou qui nous détruit, et qui détruit le monde. Entre écologie et littérature, de plus en plus de ponts sont amenés à se tendre. Quelqu’un qui lutte pour préserver des écosystèmes ne peut que lutter pour la survivance des mots anciens, porteurs d’autres façons de vivre et de penser, ou pour la survivance et la mise en valeur des toponymes, qui disent également beaucoup sur la manière que nous avons d’occuper les lieux. Pour moi, le plus grand texte littéraire n’a rien à voir avec le roman. C’est un texte qui ne serait fait que de toponymes et de lieux-dits. Tout ce qu’un être humain doit savoir s’y trouverait caché. Mon rapport à la nature passe par là, des lieux-dits et des mots qui me mettent en présence de choses que j’ignorais et que j’apprends à observer différemment. Je trouve essentiel de regarder d’abord les petites choses. Un petit village. Une petite fontaine. Puis, au milieu de ce petit village, mangeant le mur de pierres de la petite fontaine, de regarder les plantes qui y vivent. Le monde de la nature est fait de centaines de petits mondes cachés, de vies qu’on a le pouvoir de faire briller dès qu’on les regarde et qu’on les nomme. Ainsi, le mur de la petite fontaine est rempli de chélidoine, de capillaire, de « rue des murailles » et de « ruine de Rome ». Et chacune de ses vies portent encore d’autres vies…
H.Z. : Les auteurs de SF ont toujours puisé dans l’imaginaire biblique de l’Apocalypse. Dans Moi, Marthe et les autres également, les références à la Bible sont légion : citation de la bible que Marthe garde avec elle, noms de personnages (Saul, Magdalena), mais surtout des références, comme celle du personnage Azzuto, à un juste châtiment, la ville punie étant cette fois-ci Paris au lieu de Babylone. Croyez-vous à la revanche, sinon de Dieu, de Gaïa ?
A.W. : Pas tellement, non. J’aimerais bien que certains de nos gouvernants soient punis pour leurs lâchetés et leurs mensonges, mais je ne crois ni dans le courroux de Dieu ni dans celui de Gaïa ou de Pachamama. Je crois qu’on espère le courroux de la terre, qu’on aimerait que la terre se venge, mais je ne pense pas que les choses se passent comme ça. On interprète, c’est tout. On veut comprendre. Le virus qui nous ennuie tellement pour le moment, au début, par exemple, je pensais que c’était un signe de l’invisible, une manière que l’invisible avait de se manifester à nous, comme un avertissement ou une incitation à ralentir et changer nos rythmes de vie. Mais cela répondait seulement à mon envie personnelle que les choses changent. En réalité, beaucoup de gens n’ont ni envie ni intérêt à ce que les choses changent. Les théories du complot qui ont pignon sur rue appartiennent à ces biais de pensée. On ne peut plus comprendre ce qui se passe, le monde capitaliste s’est rendu impensable, illisible, alors, dans le grand nœud des choses, on a besoin de ce Deus ex machina que sont les complots. Tout « ça » qu’on ne comprend pas, on se dit que c’est le fruit de lois occultes et d’intérêts secrets mais néanmoins réels. Je vois un retour du religieux dans ces théories, la volonté de comprendre l’inexplicable et de le « maîtriser ». Cela dit, on ne peut pas nier qu’on vit une époque très particulière. L’horizon lui-même semble masqué et, qu’on le veuille ou non, on a l’impression de vivre la fin de quelque chose… Il faudra nous guérir de cette maladie-là. La maladie de se sentir au bout de l’Histoire, de se vivre comme les derniers des derniers. Une chose est sûre, cette crise va laisser de profondes traces dans le mini-théâtre de nos nerfs et nous aurons besoin de mots nouveaux pour dire et dépasser cette expérience traumatisante. Le recul de la lumière est intérieur. La lumière disparaît non seulement du monde extérieur, mais également en nous. Elle recule en nous. L’impression qu’on vit la fin de quelque chose, ou que le monde est en train de mourir, c’est ça, notre fardeau. La punition ultime ? L’ultime châtiment ?
H.Z. : L’exergue de Moi, Marthe et les autres est d’Albert Camus (dont le nom n’a pas échappé à la ‘disparition des lettres’ pour devenir ‘Cam’) : « Et il faut que nous vivions, que nous trouvions les mots, l’élan, la réflexion qui fondent une joie, la joie. » En effet, dans un monde où ils ont tout perdu, les personnages de Marthe cherchent malgré tout à recréer la vie, l’amour, l’espoir et la joie. Même si la catastrophe écologique n’est qu’une des hypothèses possibles dans votre roman, avez-vous voulu apporter un message d’espoir pour l’humanité et la planète et, si oui, pourquoi pensez-vous qu’il est légitime d’espérer ?
A.W. : Oui, il est légitime d’espérer. Comme quelqu’un qui prierait non parce qu’il croit en Dieu, mais parce qu’il aimerait croire en Dieu. J’espère comme ça, de cette façon. Pour espérer. Que quelque chose advienne : une lumière, un souffle, autre chose que ce qu’on a constamment sous les yeux. Notre génération est truffée de contradictions. Nous ne parlons que de petits plaisirs pour le jour et la nuit, mais nous n’avons jamais été aussi malheureux. Si le mot « bonheur » est sur toutes les lèvres, c’est parce que nous l’avons perdu depuis bien des années. Moi, c’est la joie qui m’occupe. Où est-elle ? Par où est-elle morte ? Quand ? Comment ? Comme beaucoup d’entre nous, je vis depuis des années avec le sentiment que j’ai perdu ma joie quelque part, mais où ? Je ne sais plus. Je ne sais plus où j’ai perdu ma joie. Comme un type atteint d’Alzheimer, je sais que j’ai été joyeux, que j’ai souri, mais je ne me souviens plus ni quand ni comment. Marthe, c’est un livre de décombres. Un tableau qui ressemble à ceux de Soulages. Il n’y a que de la nuit. Mais les personnages, tous, cherchent dans la nuit ce qui n’est pas la nuit. « Chercher, au milieu de l’enfer, ce qui n’est pas l’enfer, et lui faire de la place, et le faire durer.» C’est Italo Calvino qui disait ça, je crois. Je trouve que c’est une phrase géniale. Dans la vraie vie, c’est une tout autre histoire, naturellement. Mais je voudrais y arriver. Pour mes enfants, pour ceux que j’aime et pour nous tous, oui, je voudrais parvenir à sauver la joie. Et là où Marthe contient un message écolo implicite, c’est dans le fait qu’on ne sauve pas la joie sans sauver ce qui, pour moi, y est attaché depuis toujours : être en lien avec d’autres formes de vie, vivant au milieu du vivant. Alfonso, le papillon qui apparaît à la fin du livre, est une manière de dire cela.
Pour citer cet article :
Antoine Wauters, Hugo Zwaenepoel, « ‘Casser les mots pile à la pliure de l’oubli’. Entretien d’Antoine Wauters avec Hugo Zwaenepoel autour de Moi, Marthe et les autres» in Literature.green, décembre 2020, URL: https://www.literature.green/casser-les-mots-pile-a-la-pliure-de-loubli-wauters/, page vue le [date].
